Responsable scientifique : Jean VIGREUX – Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche « Sociétés, Sensibilités, Soin » – LIR3S (UMR CNRS-uB 7366) ; Directeur MSH Dijon. Partenaires : Financement : AAP COLLEX 2018 et 2019 Durée : 48 mois Résumé du projet : La MSH de Dijon a été labellisée pour sa collection « Critique et Mouvements sociaux » qui rassemble de nombreuses ressources sur l’histoire des communismes (archives du Komintern, brochures de l’ancienne Bibliothèque Marxiste de Paris, plusieurs revues ou journaux du second vingtième siècle liés au Parti Communiste Français). La collection est composée de documents d’une grande diversité (archives, ouvrages et périodiques) qui ont été numérisés, indexés et mis en ligne gratuitement pour tout public (chercheurs, étudiants, etc.). Dans cette dynamique, il s’agit de renforcer et prolonger les mises à disposition d’une documentation de la galaxie communiste pour la communauté scientifique et plus largement pour tout citoyen féru d’histoire contemporaine et de sciences politiques. A ceci s’ajoute la perspective du centenaire du Parti Communiste Français, mais aussi la participation à des programmes de recherches comparées avec la Tunisie (Habib Kazdaghli, Laboratoire de Recherche sur le patrimoine, Université de Manouba, Tunisie).
![ABRICO : Archives, brochures et informations communistes]() ABRICO : Archives, brochures et informations communistes
ABRICO : Archives, brochures et informations communistes
Read more
Responsable scientifique : Jean VIGREUX – Laboratoire LIR3S (UMR CNRS-uB 7366) – Université de Bourgogne Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR CNRS – Université de Bourgogne 3516) – Fondation Gabriel Péri – Groupe de Recherche d’Histoire (GRHis – EA 3831) Université de Rouen Normandie – Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche « Sociétés, Sensibilités, Soin » (LIR3S- UMR 7366) Université de Bourgogne – Service Archives du Parti communiste français – Université de Manouba (Tunisie) – Université Roma 1, Sapienza (Italie) – Archives Départementales de Seine-Saint-Denis (AD 93). Financement : AAP CollEx Persée 2020 Durée : 24 mois Résumé du projet : Lauréat de l’appel à projet CollEx Persée en 2020, le programme « Archives, Brochures et informations communistes 2 » s’inscrit dans la suite des programmes de recherches (ABRICO et PAPRIK@2F) et opérations documentaires menés depuis une vingtaine d’années à l’université de Bourgogne et portés par la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon. L’ensemble de ces travaux participent également à abonder la Collection d’excellence de la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (MSH Dijon) « Critique et mouvements sociaux » labellisée par le groupement d’intérêt scientifique (GIS) CollEx-Persée en 2017.
L’objectif de ce programme est multiple. En premier lieu, par la nature même de l’AAP CollEx Persée qui a financé en partie le projet, la numérisation ainsi que le traitement archivistique et documentaire de ressources inédites autour de la galaxie communiste ont été réalisés. Aussi, la mise à disposition de corpus et ressources inédites permet d’impulser des recherches interdisciplinaires (philosophie, psychologie, politologie, histoire, sociologie etc.) au niveau national et international et ce dans une démarche d’Open Access (libre et gratuit pour tous dans le respect du droit d’auteur).
![ABRICO 2 : Archives, Brochures et Informations Communistes]() ABRICO 2 : Archives, Brochures et Informations Communistes
ABRICO 2 : Archives, Brochures et Informations Communistes
Read more
Responsable scientifique : Kirsten BURKHARDT-BOURGEOIS (Laboratoire CREGO – EA 7317 – UB) Partenaires : Laboratoire TIL (Centre Interlangues – EA 4182 – UB) – Institute of Argumentation, Linguistics and Semiotics (Lugano – Italie) Financement : AAP TRANSLATION 2023 Durée : janvier – décembre 2023 Résumé du projet :
Le projet ADDICTE vise, à partir d’une collaboration déjà ancienne avec des linguistiques de la faculté d’économie de l’Université de la Suisse Italienne (Lugano), à mettre en place un réseau international de chercheurs, associant sciences de gestion et sciences du langage, pour travailler sur une analyse croisée de données textuelles sur les relations entre les salariés, leurs entreprises et la réputation de ces dernières. Pour ce faire, l’aide sollicitée ici visera, à partir d’un échantillon de données, à mettre en place un protocole d’analyse et à dégager les questions de recherche pouvant déboucher sur un projet de type ANR ou européen.
![ADDICTE : Analyse croisée de données textuelles sur la vie d’entreprises : modélisation lexico-sémantique et financière]() ADDICTE : Analyse croisée de données textuelles sur la vie d’entreprises : modélisation lexico-sémantique et financière
ADDICTE : Analyse croisée de données textuelles sur la vie d’entreprises : modélisation lexico-sémantique et financière
Read more
Responsable scientifique : Martine CLOUZOT (Laboratoire ARTEHIS – UMR CNRS 6298) Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR 3516 – UB-CNRS) – Centre d’Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse (UMR 5288 – Université Toulouse-CNRS) – Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (LIC) (UMR 6303 – UB-CNRS) – Laboratoire Archéologie environnementale (ArScAn) (UMR 7041 – Université Paris-Nanterre – CNRS). Financement : AAP RNMSH-FMSH-TGIR HN (2018-2019) Durée : Février 2019 – Décembre 2020 Résumé du projet : Ce projet s’inscrit dans le temps long : du Moyen Âge au XVIIIe siècle (du berger du duc de Bourgogne à Daubenton et Buffon), à l’interface entre le passé et le présent rendu possible par le dialogue interdisciplinaire entre les sciences humaines, les sciences biologiques et les nanosciences. Les objectifs sont d’analyser les parchemins (peaux de bêtes) afin de :
Ce projet interdisciplinaire, au carrefour des sciences de la génétique, de la physique, des nanosciences et des sciences historiques, a pour objectif d’extraire et de collecter des données génétiques, biologiques et nanométriques contenues dans les parchemins médiévaux, afin de déterminer à la fois les espèces animales élevées et utilisées pour la fabrication des documents d’archives, ainsi que les différents traitements que ces peaux ont pu subir.
-déterminer les espèces animales utilisées, de contribuer à une meilleure connaissance de celles-ci, de repérer des modèles de gestion économique en matière de gestion des troupeaux et largement d’histoire de l’élevage mais aussi d’étudier la gestion de la production de livres
– d’évaluer les facteurs économiques (alimentation), environnementaux (climat) qui ont pu jouer sur la «qualité» de la production de parchemins (commerce des peaux…)
– d’analyser la gestion de la production des parchemins et des livres.
![ADN des parchemins : l’innovation scientifique au service de la valorisation du patrimoine]() ADN des parchemins : l’innovation scientifique au service de la valorisation du patrimoine
ADN des parchemins : l’innovation scientifique au service de la valorisation du patrimoine
Read more
Responsable scientifique : Laurent GAUTIER – Laboratoire TIL/Centre Interlangues (EA 4182) – Université de Bourgogne Partenaires : Laboratoire d’Informatique de Bourgogne (LIB – EA) – Université de Bourgogne / MSH Dijon (Plateforme ADN) Financement : AAP CVT ATHENA Durée : 2 ans Résumé du projet : Le projet Adwine est un « Système de recommandation intelligent » pour le Vin et la Gastronomie. Son développement s’appuie sur l’articulation des travaux des deux laboratoires en synergie avec les compétences en traitement de données textuelles développées à la MSH de Dijon à travers sa plateforme Archives – Documentation– Numérisation. Il s’inscrit dans le mouvement actuel des linked data qui rendent indispensables les interactions entre les deux disciplines. Ce projet s’inscrit dans le contexte stratégique de la transition numérique de l’économie et est orienté vers le conseil et l’aide aux consommateurs en permettant le partage pédagogique et intuitif des expériences sensibles. Fondé sur un outil de recommandation intelligent, l’application vise à faire coïncider le langage et la terminologie experts et des professionnels à ceux des consommateurs pour aboutir à une recommandation d’un vin à partir du profil spécifique de l’utilisateur consommateur. Le système de recommandation est orienté Big Data et apprentissage automatique (machine learning), permettant d’aider dans la résolution de l’évaluation de la prédiction et du classement des éléments en implémentant une suite d’algorithmes de recommandation. Il capitalise sur un ensemble de ressources orales retranscrites, produites dans le cadre d’un projet antérieur et livrant le lexique utilisé par des consommateurs non experts en situation de dégustation de vins. L’originalité de cette ressource inédite réside dans le caractère spontané et instinctif des commentaires sur la base desquels les consommateurs formulent une évaluation globale de type ‘j’aime/je n’aime pas’. Mises en regard des ontologies expert, ces données alimentent un système de recommandation en fonction des profils consommateurs pour un système applicable à l’œnologie mais aussi, de façon plus générale, à l’agro-alimentaire et à la gastronomie. Le système est développé en tant qu’application web avec une interface d’administration et une API externe permettant d’interroger le moteur de recommandation (via une application mobile ou des partenaires).
![ADWINE : Système de recommandation intelligent pour le Vin et la Gastronomie]() ADWINE : Système de recommandation intelligent pour le Vin et la Gastronomie
ADWINE : Système de recommandation intelligent pour le Vin et la Gastronomie
Read more
Porteur Scientifique : Clémentine Hugol-Gential, MCF en Sciences de l’Information et de la Communication Le projet ALIMS (Alimentation et Lutte contre les Inégalités en Milieu de Santé) est soutenu par le Programme National pour l’Alimentation (PNA) et l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).
Alimentation et Lutte contre les Inégalités en Milieu de Santé
Membres du consortium : Laboratoire CIMEOS (UB), LESSAC (Groupe ESC Dijon), Centre Georges Chevrier (UMR CNRS-UB), IREPS Bourgogne, CEN Nutriment, Slow Food Bourgogne
Partenaires terrain : Centre Georges François Leclerc, CHU de Dijon
Dates : Juin 2015 à fin 2018
Financement : global (200 k€), Programme National pour l’Alimentation sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, ANR
Aujourd’hui, nous constatons une forte disparité au niveau de la prise en charge des repas (liée à la présence d’un CLAN, d’une cuisine en interne…) mais aussi entre les unités de soins (liée aux pathologies traitées et à la sensibilisation de l’équipe soignante à l’importance du repas). Ce projet a pour ambition de remettre le repas au cœur des réflexions de santé, d’interroger son rôle dans le soin et le prendre soin et de proposer des dispositifs de prise en charge innovants.
En proposant un projet croisant différentes méthodologies (veille documentaire, analyse des pratiques, analyse des représentations, adaptation d’un outil de mesure du bien-être alimentaire) et en unissant plusieurs experts issus de différentes disciplines travaillant en lien avec l’alimentation et/ou la santé (médecin, diététicien(ne), philosophe, sémiologue, chercheurs en Sciences de l’Information et de la Communication, chercheurs en comportements alimentaires, économiste) nous souhaitons fournir ici un éclairage complet sur le traitement du repas en établissement de santé, sur son sens, sa représentation et ses enjeux en considérant l’alimentation comme un « fait social total » (Mauss, 1925 – Corbeau, 2012) et en traitant les différentes dimensions du repas (sociale, environnementale)
![ALIMS : Alimentation et Lutte contre les Inégalités en Milieu de Santé]() ALIMS : Alimentation et Lutte contre les Inégalités en Milieu de Santé
ALIMS : Alimentation et Lutte contre les Inégalités en Milieu de Santé
Read more
Responsable scientifique : Lucie BERNARD (Laboratoire TIL – Centre Interlangues – EA 4182 – UB) Partenaires : Laboratoire CRIT-Tesnière (EA 3224 – UFC) – Département de langues modernes et de traduction (UQTR – Canada) – Laboratoire LIUM (EA4023 – Le Mans Université) – Institute For Applied Linguistics and Translatology (Leipzig University – Allemagne) – Department Cognitive Science and Artificial Intelligence (Tilburg University – Pays-Bas). Financement : AAP TRANSLATION 2022 Durée : janvier – décembre 2022 Résumé du projet :
Le projet vise à créer le premier moteur de traduction automatique (TA) neuronale spécifiquement entraîné pour produire des traductions privilégiant les tournures neutres ou issues des stratégies du langage inclusif dans le domaine de la traduction de jeux vidéo. Nous cherchons à réduire les biais de genre générés par la TA générique et assurer la représentation de toutes les identités sexuelles dans le domaine vidéoludique, au travers d’une approche croisée entre linguistique de corpus et intelligence artificielle.
Le projet All-inGMT a pour but de répondre aux besoins sociétaux contemporains à l’intersection entre l’identité personnelle, l’évolution générationnelle et les pratiques du marché de la traduction. Ainsi, nous observons, tant dans la sphère publique que privée, le besoin de trouver des solutions linguistiques pour effacer la binarité des termes utilisés pour classifier le genre et assurer une transition vers une société inclusive. Or, l’usage de la TA nuit particulièrement aux processus de transfert linguistique causant des biais de genre dus à l’incapacité de ces systèmes à gérer le langage neutre ou inclusif. Dans l’industrie vidéoludique en particulier, en raison des caractéristiques intrinsèques du secteur, ces biais sont encore plus prononcés et affectent négativement les conceptions corporelles et culturelles des développeurs au niveau international. Ainsi, la création du premier système de TA neuronale spécialement entraîné pour assurer la représentation de tous les membres de la société au niveau du genre dans les jeux vidéo se révèlera être un premier maillon de choix pour faire face aux risques de la TA, qui pourraient constituer un retour en arrière, au niveau discursif, en termes d’inclusivité.
![All-inGMT : All-Inclusive Games Machine Translation]() All-inGMT : All-Inclusive Games Machine Translation
All-inGMT : All-Inclusive Games Machine Translation
Read more
Responsable scientifique : François RIBAC – Laboratoire CIMEOS Communications, Médiations, Organisations, Savoirs (EA 4177 – UB) Partenaires : École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille – Université du Maine – Université de Lille 3 – BSB (École Supérieure de Commerce de Dijon) – Haute École d’art et de design (Genève) – ADEME – Amis de la Terre (Dijon) – Museum Histoire naturelle (Dijon) – Latitude 21 / Maison de l’Environnement (Dijon) – Itinéraires Singuliers (Dijon) – Alterre – ADEME Bourgogne Franche-Comté. Financement : ADEME Durée : 3 ans (2016-2019) Résumé du projet : ce projet de recherche a pour ambition de : – Explorer l’imaginaire de la transition socio-écologique – Mettre à jour, décrire les infrastructures matérielles de la fabrication d’instruments de musique et les différents discours sur la naturalité des instruments. Engager la filière régionale dans la transition. – Analyser si et comment es arts du spectacle et de la musique ont contribué (et contribuent) à l’anthropocène. L’objectif est de lancer un processus collaboratif destiné à penser et anticiper la transition socio-écologique dans le secteur de la lutherie en Bourgogne Franche-Comté, dans un contexte où le bas coût (économique) des instruments fabriqués en Asie, la concurrence du Web et la raréfaction d’essences « exotiques » déstabilisent fortement la filière. Pour ce faire, nous réunirions orchestres classiques, luthiers, et représentant-e-s des filières de la lutherie (quatuor et guitares) et du bois (Morvan et Jura), magasins de musique, écoles, conservatoires et associations d’enseignement musical, locaux de répétition, institutions dédiées à la transition écologique, collectivités locales et état. Une première conférence exploratoire est prévue en mars 2018 à Dijon et nous nous efforcerons de lancer une dynamique pour que la filière de la lutherie imagine des solutions régionales et écologiques.
![ASMA : Arts de la scène et musique dans l’Anthropocène]() ASMA : Arts de la scène et musique dans l’Anthropocène
ASMA : Arts de la scène et musique dans l’Anthropocène
Read more
Responsable scientifique : Gilles BRACHOTTE (Laboratoire CIMEOS– EA 4177 – UB) Partenaires : Laboratoire LIB (EA 7534 – UB) – Laboratoire TIL (EA 4182 – UB) – UMR IDEES (UMR 6266 CNRS – Université de Normandie) – Start up WebDrone. Financement : AAP ANR générique édition 2023 – CE38 Durée : 42 mois Résumé du projet : Depuis plusieurs années et l’avènement des réseaux sociaux, les plateformes comme Facebook ou Twitter occupent une place importante dans l’accès et la diffusion de l’information. Elles jouent un rôle dans l’environnement global de la circulation de l’information dans une logique à la fois pluri et transmédia. Dans ce contexte d’infobesité et d’activité médiatique intense, des stratégies de communication peuvent se développer afin de manipuler l’information circulante avec des objectifs multiples : création de contre-vérité, fausses nouvelles, déformation de la réalité, modification du contexte, etc. Des moyens techniques évolués et novateurs sont alors mobilisés afin d’organiser cette manipulation de masse de l’opinion publique. Parmi les techniques déployées, l’usage de robots sociaux est de plus en plus fréquent et mobilise des outils sophistiqués et difficilement décelables par l’activité humaine. Il convient, dès lors, d’être en mesure d’identifier ces manipulateurs de manière précoce, d’anticiper leur présence en ligne mais également de comprendre leurs logiques et stratégies de fonctionnement afin de contrer les campagnes d’influence, et particulièrement dans des situations sensibles. Beelzebot a pour défi de comprendre le fonctionnement non seulement des robots sociaux (bots) mais surtout des armées de robots (botnets) implémentés au sein du dispositif sociotechnique qu’est X (anciennement Twitter). Il a aussi comme but de mesurer leur impact dans la diffusion des informations et dans la structuration des communautés et leur évolution. Ce défi et cette ambition passent par 4 points clé : 1) une détection des robots sociaux, qu’ils soient seuls, organisés en groupes, qu’ils simulent ou usurpent l’identité des utilisateurs ; 2) une typologisation des robots liée à leur fonctionnement ; 3) une mesure de leur influence dans le réseau social ; et 4) l’identification de leurs rôles dans la circulation des discours. Plus généralement, le projet vise à développer la première solution en langue française capable de mettre en évidence les stratégies de manipulation de l’information par les armées de robots dans la Xphère française.
![Beelzebot : Un dispositif de détection et d’analyse des stratégies de manipulation de l’information par les armées de robots sur Twitter]() Beelzebot : Un dispositif de détection et d’analyse des stratégies de manipulation de l’information par les armées de robots sur Twitter
Beelzebot : Un dispositif de détection et d’analyse des stratégies de manipulation de l’information par les armées de robots sur Twitter
Read more
Responsable scientifique : Martine CLOUZOT (Laboratoire ARTEHIS – UMR CNRS 6298) Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR 3516 – UB-CNRS) – Laboratoire CIAD (UB) – Université d’Anvers (Belgique) – University of Bern, Department of Musicology »- (Suisse) – Participation au GECT France, Belgique, Pays-Bas. Financement : AAP BQR UB 2021/recherche en réseau Durée : 2021-2022 Résumé du projet :
Ce projet est une nouvelle approche de raisonnement des images et de modélisation des connaissances, non seulement par les méthodes d’analyse de l’histoire de la Bourgogne ducale, mais aussi par la conception d’un ensemble d’IA hybrides et distribuées. Un premier outil a été développé pour permettre aux médiévistes d’annoter les concepts et les relations dépeintes dans l’illumination. À partir de là, une analyse d’apprentissage en profondeur est effectuée sur l’image annotée afin d’améliorer l’algorithme des réseaux neuronaux.
Cet outil centré sur les enluminures médiévales fait actuellement l’objet d’une demande de maturation portée par Sayens suite à une pré-étude de marché positive. Cette demande de BQR vise deux objectifs spécifiques : Tout d’abord, l’aide à la diffusion au niveau national et international de cette approche pour fédérer les chercheurs médiévistes et constituer une base numérique de référence sur l’analyse de l’influence dans les enluminures. Ensuite, la fédération au niveau local d’un groupe de chercheurs médiévistes et d’informaticiens pour étendre le périmètre de modélisation et de connaissance à des activités médiévales connexes comme, entre autres, la logique de dons pour étendre l’influence géopolitique ou la compréhension des logiques salariales.
![Bourgogne Ducale et Data Sciences]() Bourgogne Ducale et Data Sciences
Bourgogne Ducale et Data Sciences
Read more
![Bulletins de l’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin)]() Bulletins de l’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin)
Bulletins de l’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin)
Read more
Responsable scientifique : Jean-Philippe PIERRON – Laboratoire LIR3S (UMR CNRS-UB 7366) Partenaires : Laboratoire LIR3S (UMR CNRS-UB 7366) – FEMTO/équipe OMNI (UMR CNRS-UFC 6174) – Laboratoire Psy-Drepi (EA 7458 – Université de Bourgogne) – Chaire de recherche « Valeurs du soin » (Université Jean Moulin – Lyon III). Financement : AAP TTP (2021) Durée : Janvier 2021 – Décembre 2021 Résumé du projet :
Le projet CAN vise à étudier et problématiser la généralisation du numérique dans ses relations au travail, particulièrement dans les rapports au soin (care). Cette question du numérique aux conséquences incertaines se trouve aujourd’hui au centre de questions de société majeures : rôle du télé (télé-médecine, télé-enseignement, télé-surveillance,…) en temps de pandémie et pour lutter contre des inégalités territoriales ; nouvelles souffrances psychiques (stress, trouble de l’attention), modification des pratiques professionnelles et sociales à fort impact sur la santé mentale ; contribution à l’accompagnement de la transition écologique.
Le projet s’inscrit dans l’axe « Travail » de l’appel à projets TTP. Ce sont les rapports au travail des salarié.e.s qui seront enquêtés dans cette recherche, particulièrement les adaptations créatives mobilisées par ces dernièr.e.s pour habiter au mieux les nouveaux environnements numériques de travail et les nouvelles techniques adoptées par les entreprises et les institutions.
![CAN : Créativités et adaptations au numérique dans le monde du travail]() CAN : Créativités et adaptations au numérique dans le monde du travail
CAN : Créativités et adaptations au numérique dans le monde du travail
Read more
Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR CNRS – Université de Bourgogne 3516) – Archives Nationales, Archives départementales de BFC, Musées de la Résistance (Besançon, Saint-Brisson) et OIV.
Financement : CRBFC
Durée : février 2020-janvier 2022
Résumé du projet :
Le projet CAPTURE (Communications Patrimoine Territoires REalite) inventorie, rassemble et rend accessibles des ressources très nombreuses, diverses (textes, images, sons, monuments, etc.), éparses et non accessibles via un point d’entrée unique au sein du Portail Archives Numériques et Données de la Recherche (PANDOR) de la MSH de Dijon, d’ores et déjà « moissonné » par des infrastructures nationales liées à l’IR* Huma-Num et bientôt par les Archives de France pour une visibilité européenne. Il s’agit d’offrir au plus grand nombre des richesses patrimoniales sur des thématiques importantes concernant les sociétés rurales et/ou urbaines, comme « la Seconde Guerre mondiale », « la Vigne et le Vin », mais aussi « les métiers traditionnels de zones de moyenne montagne », et enfin « les pratiques touristiques et l’identité du Jura franco-suisse ». Associé à ce projet un contrat doctoral se nourrit de l’apport des nouvelles archives, mais les questionnements de la thèse invitent aussi à revisiter les archives. Ainsi la Bourgogne-Franche-Comté sera la seule région en province à bénéficier de ce renouveau historiographique : la sortie de guerre et le retour à la République grâce aux CDL (comités départementaux de libération) permet de mieux connaître les processus à l’œuvre et d’envisager de nouvelles comparaisons à l’échelle nationale et européenne sur le retour à l’état de droit dans le cadre de la démocratie.
Une partie exploratoire du projet, sur la thématique « Vigne & Vin », à travers le corpus du Bulletin de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, vise à tester les possibilités de la textométrie pour faire émerger de données éparses à la fois de nouvelles questions de recherche et des données valorisables, par exemple pour la mise en valeur des productions et des territoires.
![CAPTURE : Communications Patrimoine Territoires RÉalité]() CAPTURE : Communications Patrimoine Territoires RÉalité
CAPTURE : Communications Patrimoine Territoires RÉalité
Read more
Responsable scientifique : Clémentine HUGOL-GENTIAL (Laboratoire CIMEOS – EA 4177 – UB) Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR 3516 – UB-CNRS) – MSHE Besançon (plateforme SHERPA) – Laboratoire CIAD (EA 7533 – UB) – Laboratoire TIL (EA 4182 – UB) – Laboratoire ELLIADD (EA 4661 – UFC) – ARTEHIS (UMR 6298 CNRS-UB) – Ville de Dijon (Bibliothèque Municipale) – Musée de la Résistance et de la Déportation Besançon. Financement : AAP TTP (2019-2020) Durée : Février 2020 – Décembre 2020 Résumé du projet :
Le projet CHIMERE porte sur la valorisation des menus et recettes en Bourgogne Franche-Comté avec la mobilisation de deux corpus de recettes et de menus (XIX-XXe siècles) conservés par la bibliothèque municipale (Dijon) et par le Musée de la Résistance et de la Déportation (Besançon). Le traitement sera réalisé conjointement par les plateformes Archives-Documentation-Numérisation (MSH Dijon) et SHERPA NuAnCES (MSHE Besançon). La fouille et l’analyse visent à comprendre les imaginaires alimentaires qui fondent un paradigme sensible de l’expérience alimentaire.
Il s’agit ici d’amorcer le projet avec le recrutement pour 7 mois d’un post-doctorant permettant de qualifier les fonds d’archives et d’analyser les premiers éléments historiques et communicationnels.
Projet en interaction entre plusieurs disciplines, les enjeux de mémoire et de transmission seront également déterminés et formalisés par une intelligence artificielle hybride (IAH) explicable (développée par le laboratoire CIAD). La forte interdisciplinarité entre histoire, communication, linguistique et IA vise à construire des synergies entre excellence scientifique et champs d’innovations prioritaires, en résonance avec la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin et le projet de Territoire d’Innovation.
Le réseau des MSH permet de s’inscrire dans cette logique territoriale forte visant à ouvrir les initiatives régionales vers tout le territoire national, à destinations de tous les chercheurs et du grand public.
![CHIMERE : Communication, Histoire et Innovation autour des Menus et Recettes]() CHIMERE : Communication, Histoire et Innovation autour des Menus et Recettes
CHIMERE : Communication, Histoire et Innovation autour des Menus et Recettes
Read more
Responsable scientifique : Jean-Jacques BOUTAUD – Laboratoire CIMEOS (EA 4177) – Université de Bourgogne Partenaires : Laboratoire TIL/Centre Interlangues (EA 4182) – Université de Bourgogne / Laboratoire ELLIAD (EA 4661) – Université de Franche-Comté Financement : AAP TTP (« Travail, Transmission, Pouvoirs ») – MSH Dijon et MSH Besançon Durée : 8 mois Résumé du projet : ce projet vise à étudier la production et le traitement d’informations entre patients atteints du cancer, afin de partager leurs expériences, leurs connaissances à l’intérieur de communautés numériques empiriquement et durablement construites. Il s’agit d’identifier ce type de sources mises en partage entre patients (veille), la nature des informations (analyse sémantique) et leurs critères de pertinence. Pour des patients atteints du cancer, la transmission et le partage d’information sont vitaux, tout particulièrement pour ce qui concerne les bonnes pratiques, les pratiques de prévention. L’alimentation est un paramètre essentiel dans le processus de soin tant au plan physiologique qu’au plan psychologique. Dans un contexte très important de reprise en main de leur maladie et de leur situation, les patients recherchent une information fiable et rassurante sur les régimes alimentaires à adopter et/ou privilégier. Partager ces informations participe du processus de réassurance et de prise en charge de sa maladie, qui est une forme de résilience au niveau du patient et de ses proches. C’est pourquoi se multiplient aujourd’hui des espaces en ligne et des mises en réseau d’information que les patients consultent ou enrichissent. Ce projet s’inscrit dans cette logique. Il vise à étudier les réseaux ainsi construits, la nature des informations mises en valeur et en circulation pour faciliter chez les patients la transmission et le partage des connaissances, des expériences.
Circularité de l’Information entre Patients autour des Pratiques Alimentaires (CIPPA)
![CIPPA : Circularité de l’Information entre Patients autour des Pratiques Alimentaires]() CIPPA : Circularité de l’Information entre Patients autour des Pratiques Alimentaires
CIPPA : Circularité de l’Information entre Patients autour des Pratiques Alimentaires
Read more
Responsable scientifique : Dominique ANDOLFATTO (Laboratoire CREDESPO – Université de Bourgogne) Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR CNRS – Université de Bourgogne 3516) – Laboratoire CREDESPO (Université de Bourgogne) – Laboratoire CID-chaire Smartcity et gouvernance de la donnée (Université de Bourgogne) – Laboratoire CREDIMI (Université de Bourgogne) – Laboratoire APEMAC (Université de Lorraine) – Laboratoire IRENEE (Université de Lorraine) – Laboratoire IFG (Université de Lorraine) – Laboratoire LADYSS-CNRS (Université de Paris) – Laboratoire CERAPS (Université de Reims Champagne-Ardenne) – Laboratoire CRJFC (Université de Franche-Comté) – Université de Bologne (Italie) – School of Law/ U. publique Hiroshima (Japon) – Nouvelle Université bulgare/Sofia (Bulgarie) – Université des études étrangères de Tokyo (Japon) – IFEA-CNRS/ Bogota (Colombie) – Laboratoire Dynam (Université de Strasbourg) – Institut Hanna-Arendt/Université technique Dresde (Allemagne) – Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales/Université Mohammed V, Rabat (Maroc). Financement : AAP RNMSH 2021 Durée : 24 mois Résumé du projet : La nécessité de mesures d’urgence puis la gestion de la crise sanitaire ont conduit, à compter de mars 2020, à des décisions et à la mise en œuvre de mécanismes décisionnels inédits. Si, l’Etat de droit et la démocratie représentative n’ont pas été suspendus, des procédures et un droit d’exception ont été mis en place et les libertés publiques limitées. Certes ce contexte n’a pas interdit au débat public de se poursuivre, notamment dans les assemblées électives mais, pour la première fois, dans une société libérale en temps de paix, la pensée critique a pu paraître suspecte…
Pour éclairer et analyser ces différents aspects, nous proposons d’engager une recherche collective associant juristes, politistes, sociologues et historiens, principalement issus des universités de Bourgogne et de Lorraine…
D’abord sur le plan politique. Comment le dispositif de la décision politique s’est-il adapté et a-t-il été perçu par les citoyens ? … Nous proposons d’analyser ce nouveau mode de gouvernance, son rapport aux citoyens, mais aussi les interventions de ces derniers dans l’arène politique.
La gestion politique de la crise sera abordée sous différents aspects et méthodes : analyse de la popularité des gouvernements ; instruments constitutionnels utilisés ; contentieux constitutionnels ; mécanismes de décision et recours à l’expertise ; comitologie ; gouvernance par les données…
Un deuxième temps ciblera l’évolution en parallèle de la citoyenneté sociale. Celle-ci concerne d’abord les travailleurs. La crise sanitaire a eu un impact important sur le monde du travail et ses régulations. Il s’agit d’analyser comment ce dialogue et ses acteurs (organisations syndicales et d’employeurs, pouvoirs publics) se sont adaptés au nouveau contexte…
Enfin, la crise épidémique a conduit à une mise entre parenthèses de la démocratie sanitaire, issue de réformes depuis les années 2000. Celles-ci ont cherché à mieux associer les patients (et plus largement les citoyens et leurs associations représentatives) aux choix sanitaires et sociaux, à la gestion de l’hôpital, tout en renforçant les droits des mêmes patients. Cette citoyenneté est probablement celle qui a le plus souffert de la crise. Comment la préserver en effet dans un contexte d’urgence sanitaire dans laquelle les structures hospitalières et leurs personnels ont été mobilisés ? …
![CITOYEN : Citoyennetés politique, sociale, sanitaire et numérique au prisme de l’épidémie de Covid-19]() CITOYEN : Citoyennetés politique, sociale, sanitaire et numérique au prisme de l’épidémie de Covid-19
CITOYEN : Citoyennetés politique, sociale, sanitaire et numérique au prisme de l’épidémie de Covid-19
Read more
Responsable scientifique : Gilles BRACHOTTE – Laboratoire CIMEOS Université de Bourgogne Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR CNRS – Université de Bourgogne 3516) – Laboratoire CIMEOS (Université de Bourgogne) – Laboratoire TIL (Université de Bourgogne) – CSGA (Université de Bourgogne) – Laboratoire ELLIAD (Université de Franche-Comté) – Pôle de compétitivité Vitagora – Atol Conseil Développement – Webdrone. Financement : AAP 2019 ISITE-BFC – BPI France – UBFC – Dijon Métropole – FEDER
Durée : 42 mois
Résumé du projet : le projet COCKTAIL vise à créer un observatoire en temps réels des tendances, des singularités et des signaux faibles, circulant dans les discours du domaine alimentaire. Il s’agit de mettre à disposition du grand public, des entreprises et des organisations, un espace dédié aux tendances et aux innovations dans l’alimentaire. Cocktail est un projet fondamentalement sociétal car il traite le sujet essentiel pour l’Homme qu’est l’alimentation et la sécurité alimentaire dans un espace public et médiatique en reconfiguration par le numérique. Dans une approche pluridisciplinaire, il convient alors de comprendre et d’analyser la prise de forme de la communication, la circulation des discours ainsi que les interactions et les dynamiques aux temporalités accélérées qui s’exercent sur le dispositif Twitter qui sert de « chambre de résonance » et, qui influe, de facto, les politiques publiques, industrielles et les comportements de consommation/consommateurs.
La plateforme numérique développée associera big data, outils d’analyse en temps réel, algorithmes d’intelligence artificielle pour le traitement des données massives régies par des codes d’usage du dispositif tels que les opérateurs ou les pratiques. L’ensemble induisant une variabilité sémantique, la plateforme proposera des analyses contextuelles multi-niveaux (macro, méso, micro) intégrant la sémantique des domaines métiers considérés (dans notre cas le domaine alimentaire modélisé par une ou plusieurs ontologies existantes (Ibanescu, 2009) ou développée pour le projet).
![COCKTAIL : Analyse en temps réel des discours alimentaires sur Twitter]() COCKTAIL : Analyse en temps réel des discours alimentaires sur Twitter
COCKTAIL : Analyse en temps réel des discours alimentaires sur Twitter
Read more
Responsable scientifique : Thomas THEVENIN – Laboratoire THEMA (UMR CNRS-uB 6049) – Université de Bourgogne Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR CNRS – Université de Bourgogne 3516) – Laboratoire THEMA (UMR CNRS-uB 6049) – Université de Bourgogne – INED (Institut National d’Etudes Démographiques) – Université de Cambridge / CAMPOP. Financement : Appel à projets générique (PRC) ANR 2019 / Culture, créations, patrimoine Durée : 36 mois Résumé du projet : Le projet COMMUNE-HISDBD ambitionne de 1) produire le premier SIG-historique SIG-H au monde restituant, année par année, de la Révolution à nos jours, les délimitations exactes des communes, en y associant les données de population et l’accès aux réseaux de transports. 2) Développer un modèle multimodal du réseau de transports, support de l’analyse des changements économiques et démographiques de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. 3) Représenter et analyser à une échelle très fine quelques-uns des phénomènes démo-socio-économiques. Enrichi d’autres informations historiques, ce SIG-H sera un outil de référence pour les chercheurs en sciences humaines et sociales. Un tel outil manque à la recherche française et européenne car, faute de s’être appuyées sur des documents historiques, aucune des tentatives précédentes n’a réussi à produire une base de données cartographique fiable et précise de tous les changements de limites administratives.
![COMMUNE-HISDBD : Microcartographie collaborative de données historiques inexploitées : reconstitution des limites communales (France métropolitaine)]() COMMUNE-HISDBD : Microcartographie collaborative de données historiques inexploitées : reconstitution des limites communales (France métropolitaine)
COMMUNE-HISDBD : Microcartographie collaborative de données historiques inexploitées : reconstitution des limites communales (France métropolitaine)
Read more
Responsable scientifique : Olivier JACQUET – LIR3S (UMR CNRS-uB 7366) ; Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » de l’Université de Bourgogne. Partenaires : Institut universitaire de la Vigne et du Vin “Jules Guyot” (UB) – UMR Procédés Alimentaires et Microbiologiques (PAM) AgroSup Dijon/UB – UMR 5319 CNRS Passages (Université Bordeaux Montaigne)Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne – Groupe international d’Experts en Systèmes vitivinicoles pour la CoOpération (GiESCO) – Bibliothèque Nationale de France (BNF) – UMR 7324 Citeres Laboratoire Archéologie et Territoires (LAT) (Université de Tours) – Centre d’Histoire « Espaces & Cultures » (Université Clermont-Auvergne) – University of Melbourne, Department of French studies (Australie) – Institute for Wine Biology, Stellenbosch University (Afrique du Sud) – Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”, Università degli Studi di Milano (Italie) Financement : AAP COLLEX 2018 et 2019 Durée : 48 mois Résumé du projet : L’objectif recherché est dans un premier temps de poursuivre la politique documentaire 3.0 initiée par la MSH de Dijon depuis plusieurs années, et ce grâce à la diffusion en accès ouvert et gratuit d’une revue professionnelle ancienne, inédite au format numérique : Le Progrès agricole et viticole. La seconde partie du projet consiste en l’élaboration d’un corpus numérique signalant des publications anciennes, du XVIIIe à 1950, déjà présentes en ligne ou restant à numériser. Le traitement de ces deux corpus, distinct en matière de méthodologie, favorise la mise en place d’approches holistiques et multiscalaires d’un intérêt scientifique indéniable. En outre, l’histoire des sciences et techniques vitivinicoles n’est pas la seule à profiter de ce projet puisque ce dernier englobe dans le même souci d’exhaustivité certains aspects juridiques, économiques et socio-culturels inhérents au monde de la vigne et du vin. L’objectif affiché permettra non seulement de mieux appréhender la place de la France dans le monde en tant que pays producteur, mais aussi d’envisager ses interactions avec d’autres nations viticoles au cours des trois derniers siècles. Enfin en se plaçant sous le signe de l’histoire globale, CONVEX 2 ne s’adresse pas uniquement aux chercheurs en sciences humaines et sociales, mais aussi aux professionnels de la filière vitivinicole ainsi qu’à un public curieux de découvrir un monde en constante mutation. Ces ressources viendront alimenter les collections relatives à la vigne et au vin diffusées par la MSH de Dijon et labellisées par CollEx en 2017.
![CONVEX : Collection numérique vitivinicole d’excellence]() CONVEX : Collection numérique vitivinicole d’excellence
CONVEX : Collection numérique vitivinicole d’excellence
Read more
Responsable scientifique : Olivier JACQUET – Laboratoire LIR3S (UMR CNRS-uB 7366) – Université de Bourgogne Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR CNRS – Université de Bourgogne 3516), Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » de l’Université de Bourgogne, Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne, Groupe international d’Experts en Systèmes vitivinicoles pour la CoOpération (GiESCO), Bibliothèque nationale de France, Institut universitaire de la Vigne et du Vin « Jules Guyot » – Université de Bourgogne, UMR 7366 CNRS LIR3S -Université de Bourgogne, UMR Procédés Alimentaires et Microbiologiques (PAM) AgroSup -Université de Bourgogne, UMR 5319 CNRS Passages – Université Bordeaux Montaigne, UMR 7324 Citeres Laboratoire Archéologie et Territoires (LAT), Université de Tours, Centre d’Histoire « Espaces & Cultures » – Université Clermont-Auvergne, University of Melbourne, Department of French studies (Australie), Institute for Wine Biology, Stellenbosch University (Afrique du Sud), Dipartimento di Filosofia « Piero Martinetti » -Università degli Studi di Milano (Italie). Financement : AAP CollEx Persée 2020 Durée : 24 mois Résumé du projet : Le programme « Collection numérique vitivinicole d’excellence 2 » (CONVEX2) a été lauréat de l’appel à projet CollEx Persée 2020 et fait suite à de nombreux travaux scientifiques et documentaires engagés depuis une quinzaine d’année à la MSH de Dijon, au sein des laboratoires de l’université de Bourgogne ainsi qu’à la Chaire Unesco Culture et Tradition du Vin. Ces actions sont menées en collaboration avec les grands acteurs nationaux et internationaux de la filière « Vigne et Vin ».
L’objectif du programme CONVEX 2 est multiple. D’une part, il contribue à renforcer les ressources et matériaux de recherche mis à disposition de la communauté scientifique mais également du grand public. Le traitement documentaire du « Progrès Agricole et Viticole » ainsi que la constitution d’un répertoire numérique de la vigne et du vin sont des ressources inédites dans le domaine de la vigne et du Vin. D’autre part, l’accomplissement du programme va permettre de multiplier le croisement des sources et d’insuffler de nouvelles recherches dans le domaine. Enfin, celui-ci permettra à court et moyen termes de nouer un partenariat et une collaboration avec la BNF (Gallica) autour des collections vitivinicoles.
![CONVEX 2 : Collection numérique vitivinicole d’excellence]() CONVEX 2 : Collection numérique vitivinicole d’excellence
CONVEX 2 : Collection numérique vitivinicole d’excellence
Read more
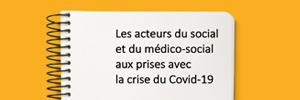
Lors de la crise du COVID-19, l’ANR avait lancé un appel à projet spécifique dit « Flash » pour pouvoir soutenir, via un processus spécifique accéléré, des projets de recherche sur des thématiques liées à cette pandémie impliquant à la fois des acteurs de la société civile et des scientifiques. C’est dans ce cadre que le CREAI BFC (organisme associatif d’intérêt général engagé en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et des acteurs du secteur social, médico-social et sanitaire) a sollicité la MSH de Dijon pour structurer une équipe de recherche pluridisciplinaire en Sciences Humaines et Sociales, afin d’analyser un corpus constitué de journaux de bords de professionnels du social et du médico-social. Ces documents, inédits et rares, regroupaient ainsi les témoignages de 65 professionnels qui racontaient leur quotidien face à une crise sanitaire d’ampleur, lors de la première vague du Covid-19 (premier semestre 2020). Ces récits ont ainsi été analysés par 7 CREAI en France, fédérés par l’AN-CREAI, ainsi que par les 14 chercheurs issus de 4 laboratoires du grand campus dijonnais réunis par la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) de Dijon. L’équipe de recherche structurée par la MSH de Dijon et coordonnée par Karen BRETIN était composée comme suit : – CESAER : Pierre WAVRESKY. – CREGO : Adrien BONACHE – Anne BUTARD – Irina PALADI – Benoit PIGÉ. – LIR3S : Karen BRETIN – Jean-Philippe PIERRON – Marielle POUSSOU-PLESSE. – PSY-DREPI : Laurent AUZOULT-CHAGNAULT – François-Xavier MAYAUX – Brigitte En savoir plus : consultez le tome de l’étude consacré au travail des
MINONDO-KAGHAD – Christelle VIODÉ – Edith SALÈS-WUILLEMIN.
chercheurs
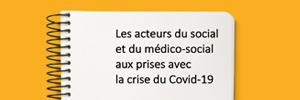 CRISEsoc.JdB : Les acteurs du social et du médico-social aux prises avec la crise du COVID 19
CRISEsoc.JdB : Les acteurs du social et du médico-social aux prises avec la crise du COVID 19
Read more
![DESIR : Détection de structures patrimoniales à partir d’images haute résolution]() DESIR : Détection de structures patrimoniales à partir d’images haute résolution
DESIR : Détection de structures patrimoniales à partir d’images haute résolution
Read more
Responsable scientifique : Hervé MARCHAL (LIR3S – UMR 7366 CNRS-uB). Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR 3516) – Laboratoire d’Innovation Territoriale (MSH Dijon) – PUDD (MSH Dijon) – Laboratoire THEMA (UMR CNRS-uB 6049) – Université d’Antananarive (UA – Madagascar) – Comité de recherche 01 « Identité, espace et politique » de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) Financement : AAP BQR UB 2022 Durée : janvier – décembre 2022 Résumé du projet :
Le projet en cours avec la commune de Mamoudzou (Mayotte) consiste à conduire un diagnostic socio-territorial réalisé sur le territoire même de la capitale du département français d’outre-mer de Mayotte et appuyé par une démarche scientifiquement éprouvée. La mairie de Mamoudzou et l’Université de Bourgogne, plus précisément le laboratoire interdisciplinaire de recherche « sociétés, sensibilités, soins » (LIR3S – UMR CNRS 7366), sont en lien étroit pour réaliser un tel diagnostic (une convention de collaboration de recherche est en cours de rédaction). En outre, la réalisation d’une thèse de doctorat réalisée par Essoubiyou Djafallo sous la direction du Professeur Hervé Marchal (LIR3S – UB) vient de commencer. Cette thèse est financée dans le cadre des fonctions professionnelles de Mr Djafallo Essobiyou, lequel est en effet responsable du service Attractivité économique et des Données statistiques de la Mairie de Mamoudzou.
![Diagnostic socio-territorial sur la commune de Mamoudzou (Mayotte)]() Diagnostic socio-territorial sur la commune de Mamoudzou (Mayotte)
Diagnostic socio-territorial sur la commune de Mamoudzou (Mayotte)
Read more
Responsable scientifique : Karen BRETIN-MAFFIULETTI – Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche « Sociétés, Sensibilités, Soin » – LIR3S (UMR CNRS-uB 7366) Partenaires : Psy-DREPI (EA 7458 – UB) – CREDESPO (EA 4179 – UB) – TIL – Centre Interlangues (EA 4182 – UB) – IREDU (EA 7318 – UB) – CRJFC (EA 3225 – UFC) – GEMASS (UMR 8598 – Université Paris-Sorbonne) – – URePSSS (EA 7369 – Université de Lille) Financement : AAP TTP 2018 (Fédération des MSH Bourgogne Franche-Comté) Durée : 1 an Résumé du projet : Le projet DIES a pour ambition de construire un objet de recherche collectif et pluridisciplinaire autour de la question des espaces sociaux, dont on interrogera en particulier les conditions d’émergence, les dynamiques d’évolution et les modes de régulation. Les espaces sociaux sont conçus comme des domaines d’activités sociales. Une attention particulière est accordée aux espaces du « travail » et du « hors travail » : l’activité professionnelle et l’engagement des groupes dans les loisirs (notamment sportifs) constituent des pistes de recherche déjà repérées (et présentées à l’occasion du 15e anniversaire de la MSH Dijon) par les chercheurs impliqués dans le projet. L’engagement des individus dans l’action politique ou citoyenne est également analysé par plusieurs membres de l’équipe, comme déterminant de l’émergence d’espaces de pouvoir renouvelés.
![DIES : Définir et interroger les espaces sociaux : théories, méthodes, actualité de la recherche]() DIES : Définir et interroger les espaces sociaux : théories, méthodes, actualité de la recherche
DIES : Définir et interroger les espaces sociaux : théories, méthodes, actualité de la recherche
Read more
![DTA Sports : Diagnostic-préconisations sur la politique sportive de la ville de Dijon]() DTA Sports : Diagnostic-préconisations sur la politique sportive de la ville de Dijon
DTA Sports : Diagnostic-préconisations sur la politique sportive de la ville de Dijon
Read more
Responsable scientifique : Laurent GAUTIER – Laboratoire TIL/Centre Interlangues (EA 4182) – Université de Bourgogne Partenaires : Laboratoire d’Informatique de Bourgogne (LIB – EA) – Université de Bourgogne / MSH Dijon (Plateforme ADN) Résumé du projet : e-GREETERS / Tourist’You est un système d’information touristique d’un nouveau genre basée sur un corpus oral d’anecdotes authentiques et originales visant à mettre en valeur le patrimoine d’une zone géographique ou lié à un thème. TouristYou est un dispositif d’aide au « tourisme expérientiel » qui associe plusieurs compétences interdisciplinaires et qui permet : – une collecte et un traitement d’enregistrements audio/vidéo pour révéler l’aspect historique de l’anecdote ; – une analyse linguistique et un traitement sémantique pour affiner ce découpage et pour extraire, par annotations fines, le meilleur de l’anecdote et alimenter un système d’information associant cartographie, base de données et intelligence artificielle. Le système ainsi développé permet de proposer aux acteurs du tourisme : Le système ainsi développé permet de proposer aux touristes/visiteurs :
e-GREETERS / Tourist’You
![e-GREETERS / Tourist’You : système d’information touristique basée sur des anecdotes authentiques]() e-GREETERS / Tourist’You : système d’information touristique basée sur des anecdotes authentiques
e-GREETERS / Tourist’You : système d’information touristique basée sur des anecdotes authentiques
Read more
Responsable scientifique : Raphaël MAUREL (CREDIMI – EA 7532 – UB) Partenaires : LEDI (Laboratoire d’Economie de Dijon – EA 7467 – UB) – CSIT – Centre for Secure Information Technologies (Queen’s University – Belfast – Irlande du Nord) – Laboratoire TRIANGLE (UMR 5206 – Université Lyon 2) – Laboratoire CID (EA 7531 – UB) – Laboratoire CRISS (Université Polytechnique – Hauts de France) – Laboratoire LEFMI (Université Picardie Jules Verne) – Laboratoire CRJFC (UFC) – Centre E. Durkheim (Sciences Po Bordeaux) – Laboratoire IREGE (Université Savoie-Mont-Blanc). Financement : AAP TRANSLATION 2023 Durée : janvier – décembre 2023 Résumé du projet :
Le projet ENCYPT s’inscrit dans le programme ALADIN, consacré à l’analyse de l’élaboration d’un droit international du numérique initié au sein du CREDIMI. Il vise à déterminer, grâce à une approche pluridisciplinaire et transversale réunissant informaticiens, philosophes, économistes ou encore juristes, la pertinence, le niveau optimal et les moyens d’un encadrement juridique des cryptoactifs, phénomène technico-économique aux enjeux politiques et éthiques majeurs.
Le projet est directement en lien avec la thématique de la « circulation des biens et des personnes » dans la mesure où il contribue à analyser l’encadrement juridique de la circulation des actifs numériques, souvent considérés – à tort ou à raison – comme de véritables monnaies sur le marché économique mondial. Il interroge à cet égard l’idée de transition sociétale fondée sur la représentation de ses valeurs économiques, monétaires, mais aussi technologiques, en questionnant le passage du tangible à l’immatériel.
![ENCRYPT : L’ENcadrement des CRYPtoactifs. De la lex crypto-monetea à l’éthique du numérique]() ENCRYPT : L’ENcadrement des CRYPtoactifs. De la lex crypto-monetea à l’éthique du numérique
ENCRYPT : L’ENcadrement des CRYPtoactifs. De la lex crypto-monetea à l’éthique du numérique
Read more

Dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche entre la MSH Dijon et le Département de la Côte d’Or (CD21), une équipe de recherche pluridisciplinaire en Sciences Humaines et Sociales, en appui sur la Plateforme Universitaire de Données de Dijon (PUDD), a mené une étude de cohorte sur le cumul entre le RSA et les salaires d’une reprise d’emploi en Côte d’Or. Le Département a ainsi souhaité mettre en place cette étude afin d’en évaluer les effets sur les parcours des bénéficiaires du RSA et mesurer les différents facteurs susceptibles d’être porteurs d’une efficacité des dispositifs d’insertion ciblés sur les parcours de vie des personnes. Cette étude, à travers la collecte et l’analyse de différentes données, ainsi qu’à la suite d’un travail d’enquête auprès des bénéficiaires, porte sur différents aspects liés à la mise en place du dispositif de cumul. Il s’agissait ainsi d’apporter des réponses aux questions suivantes : → Quels sont les publics concernés ? → Quels sont les emplois concernés ? → Que deviennent les bénéficiaires du dispositif ? → Quel impact du dispositif de “cumul” sur la reprise d’emploi ? L’équipe de recherche structurée par la MSH de Dijon était composée comme – PSY-DREPI : Pierre DE OLIVIEIRA – Lucie FINEZ – Anthony CLAIN. – LIR3S : Hervé MARCHAL – Marine PHILIPPONEL. – LEDI : Jimmy LOPEZ. – PUDD : Cyrinus ELEGBEDE – Marie MBOME. En savoir plus : consultez la synthèse de l’étude
suit :
 Étude de cohorte sur le cumul Revenu de Solidarité Active (RSA) et salaires d’une reprise d’emploi en Côte d’Or
Étude de cohorte sur le cumul Revenu de Solidarité Active (RSA) et salaires d’une reprise d’emploi en Côte d’Or
Read more
Responsable scientifique : Hervé MARCHAL (LIR3S – UMR CNRS-uB 7366) Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR 3516) – Laboratoire Groupe de recherche interdisciplinaire sur les vieillissements (GRIVES) (Université de Namur – Belgique) – Centre d’étude des mouvements sociaux (CEMS – EHESS CNRS – Université Paris Descartes Sorbonne) – Laboratoire lorrain de sciences sociales (2L2S – EA 3478 – Université de Lorraine) – Chaire internationale Sociétés inclusives et avancées en âge (SIAGE) (Université de Lorraine) – Laboratoire Identité et différenciation de l’espace, de l’environnement et des sociétés (IDESS – UMR 6266 CNRS – antenne CIRTAI – Université Le Havre) – Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) – Revue scientifique internationale Retraite & société – Revue scientifique internationale Gérontologie et société – Association française de sociologie (AFS) – Réseau Villes amie des Aînés – Pôle de gérontologie et d’innovation (PGI) de Bourgogne-Franche-Comté. Financement : AAP TRANSLATION 2023 Durée : janvier – décembre 2023 Résumé du projet :
Le fonds de la Fondation nationale de gérontologie (FNG) permet de retracer plus de 50 ans d’histoire de la gérontologie en France et des politiques publiques afférentes. Il est à n’en pas douter d’une haute valeur scientifique et politique au regard de l’actualité (assez dramatique il faut le dire) de la question de la prise en charge des personnes âgés dans des établissements spécialisés. Ce fonds rassemble plus largement des documents dans une approche transversale et pluridisciplinaire autour des questions de vieillissement et de la gérontologie.
La sauvegarde, le traitement et la mise à disposition de ce fonds par la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon va permettre une exploitation scientifique pluridisciplinaire et internationale dans l’objectif de faire de ce fonds unique et précieux un commun accessible non seulement aux chercheurs mais aussi aux institutions.
![FNG : Perspectives scientifiques internationales et pluridisciplinaires autour du fonds d’archives de la Fédération nationale de gérontologie]() FNG : Perspectives scientifiques internationales et pluridisciplinaires autour du fonds d’archives de la Fédération nationale de gérontologie
FNG : Perspectives scientifiques internationales et pluridisciplinaires autour du fonds d’archives de la Fédération nationale de gérontologie
Read more
Responsable scientifique : Will NOONAN (Laboratoire TIL – Centre Interlangues – EA 4182 – UB) Partenaires : Financement : AAP TRANSLATION 2022 Durée : janvier – décembre 2022 Résumé du projet :
Le projet GamiShT est pensé et structuré autour d’un livrable innovant : un serious game permettant à un public varié (chercheurs, étudiants des cycles L et M…) d’explorer des problématiques liées au genre, aux injures et à l’humour issues de textes et de traductions françaises de Shakespeare. Les collaborations interdisciplinaires nécessaires à cette création apporteront un éventail d’applications scientifiques et pédagogiques, tout en développant un réseau de recherche international déjà en cours de construction, qui sera porteur de futurs projets.
Situé au croisement entre langue, culture, texte et nouvelles technologies, le projet GamiShT implique de nombreux partenaires et possède un fort potentiel de développement. Son thème shakespearien offre plusieurs points de convergence avec l’axe « TransLation » : dans le transfert linguistique, culturel et diachronique impliqué par les processus de traduction, dans la circulation des textes, des idées, des pratiques éducatives et sociales impliquées par la transmission d’œuvres classiques à de nouveaux publics, et dans l’évolution des rapports au genre, au discours d’injure et à l’humour à travers les différentes versions des textes et leurs contextes. Ces liens thématiques sont renforcés par la dimension technologique du projet, dont le format vidéoludique offre une occasion pour étudier le rapport du joueur au jeu et aux textes qui le constituent mais aussi pour explorer les connexions possibles entre textes et questions (inter)disciplinaires, à travers des interactions conçues comme des représentations concrètes et accessibles de problématiques ayant une portée à la fois scientifique et pédagogique. Constituant un support de médiation innovant pour l’étude des œuvres classiques et de leurs traductions, le processus de « gamification » fait également écho à la notion de « négociation » textuelle évoquée par Stephen Greenblatt, qui voit en l’étude de l’œuvre de Shakespeare une manière de mieux comprendre la « circulation de l’énergie sociale » à travers les langues et les siècles.
![GamiShT : Gamification de Shakespeare et de ses Traductions : genre, injure et humour]() GamiShT : Gamification de Shakespeare et de ses Traductions : genre, injure et humour
GamiShT : Gamification de Shakespeare et de ses Traductions : genre, injure et humour
Read more
Responsable scientifique : Thomas THEVENIN – Laboratoire de géographie – THEMA, antenne dijonnaise (UMR CNRS-UB 6049) Partenaires : TIL – Centre Interlangues (EA 4182 – UB) – ELLIAD (EA 4661 – UFC) Financement : AAP TTP 2018 (Fédération des MSH Bourgogne Franche-Comté) Durée : 1 an Résumé du projet : Les méthodologies d’analyse linguistique permettent aujourd’hui d’explorer de grands ensembles de données textuelles, mais aussi de les coupler avec des techniques de géolocalisation. Ces deux grandes tendances participent à l’émergence d’un champ d’investigation dérivé des humanités numériques, les « spatial humanities ». Ce faisant, la dimension spatiale fait l’objet d’une attention particulière aux dépens de la dimension temporelle, pourtant fondamentale dès que les données s’inscrivent en diachronie. Ce projet a pour ambition de combiner des informations spatiales et temporelles pour explorer de nouveaux corpus. Ce projet a pour objectif de montrer l’impact des réseaux de chemin de fer sur les dynamiques territoriales et à l’inverse comment les dynamiques territoriales ont influencé le tracé de ces réseaux. Si les dimensions techniques et économiques ont été largement explorées, la dimension politique reste souvent évoquée sans être étudiée de façon systématique, ni sur une base empirique large. Nous proposons, dans ce projet, de montrer l’influence du pouvoir politique sur la construction du réseau ferré de 1880 à 1946 à partir de données reliées (linked data) et par une analyse semi-automatique tenant compte de leur historicité.
![HUMASPATIA : Humanités spatiales : développement d’une méthodologie pour l’analyse spatiale et temporelle]() HUMASPATIA : Humanités spatiales : développement d’une méthodologie pour l’analyse spatiale et temporelle
HUMASPATIA : Humanités spatiales : développement d’une méthodologie pour l’analyse spatiale et temporelle
Read more
Responsable scientifique : Martine CLOUZOT (Laboratoire ARTEHIS – UMR CNRS 6298) Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR 3516 – UB-CNRS) – Laboratoire ARTEHIS (UMR CNRS-UB 6298) – Laboratoire Le2i (Université de Bourgogne). Financement : AAP RnMSH – MI – Projet Exploratoire Premier Soutien (PEPS) (2017) Durée : octobre 2017 – décembre 2018 Résumé du projet :
Ce projet concerne les domaines de l’ingénierie des connaissances et des enluminures médiévales. Dans ce projet, nous considérons l’enluminure comme un graphe de connaissances. Ce graphe était utilisé par les élites au Moyen Age pour se représenter comme groupe social et représenter les grandes étapes de leur vie. Pour ce faire, des combinaisons d’éléments symboliques sont utilisées pour encoder des messages d’influence, plus ou moins implicites. Notre travail est d’identifier la signification de ces éléments au travers d’une approche de modélisation logique en utilisant des ontologies. L’idée à terme est d’identifier les raisonnements logiques et de les simuler à l’aide de mécanismes d’intelligence artificielle pour, d’une part, faciliter l’interprétation des enluminures et d’autres part fournir une formalisation logique de nouveaux services d’encodages et de transmission de l’information dans les futures évolutions des réseaux sociaux actuels.
![ILLUMINATION 3.0 : Numérisation et analyse des influences sociales au travers des enluminures du XVème siècle. Un enseignement pour les réseaux sociaux de demain.]() ILLUMINATION 3.0 : Numérisation et analyse des influences sociales au travers des enluminures du XVème siècle. Un enseignement pour les réseaux sociaux de demain.
ILLUMINATION 3.0 : Numérisation et analyse des influences sociales au travers des enluminures du XVème siècle. Un enseignement pour les réseaux sociaux de demain.
Read more
Responsable scientifique : Karen BRETIN-MAFFIULETTI – Laboratoire LIR3S (UMR CNRS-uB 7366) – Université de Bourgogne Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR CNRS – Université de Bourgogne 3516) – Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche « Sociétés, Sensibilités, Soin » (LIR3S- UMR 7366) Université de Bourgogne – Centre Interlangues : Texte, Image, Langage – TIL (EA 4182), Université de Bourgogne – Centre de Recherche et d’Etudes Histoire et Sociétés – CREHS (UR 4027), Université d’Artois – Laboratoire Valeurs Innovations Politiques Socialisations et Sports – VIPS2 (UR 4636), Université de Rennes – Laboratoire Espaces Humains et Interactions Culturelles – EHIC (EA 1087), Université de Limoges – Textes et Cultures (UR 4028), Université d’Artois – Laboratoire Interactions, transferts, ruptures artistiques et culturelles – InTRu (EA 6301), Université de Tours – Centre d’Histoire Espaces et Cultures – CHEC (EA1001), Université Clermont Auvergne – Centre Nantais de Sociologie – CENS (UMR CNRS 6025), Université de Nantes – Unité de Recherche Migrations et Sociétés – URMIS (IRD UMR 205 et CNRS UMR 8245), Université de Côte d’Azur – Société Française d’Histoire du Sport (SFHS) – Comité d’organisation du congrès international « Les enjeux des Jeux », Montpellier, janvier 2022 – Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme (RnMSH). Financement : AAP CollEx Persée 2021 Durée : 24 mois Résumé du projet : Mobilisant l’expertise de la MSH de Dijon en matière de conservation et diffusion de corpus documentaires, le projet IRIS (Inventaire « Rouge » de l’Information Sportive) s’attachera à traiter et exploiter la collection complète du mensuel Miroir du cyclisme (1960-1994). Une équipe pluridisciplinaire observera, par une étude de contenus (titres, articles, iconographie, photographies), le discours médiatique (et critique) porté sur le sport par un organe de presse proche du Parti communiste français. Et ce à partir d’entrées classiques : les compétitions internationales et championnats nationaux, courses et critériums régionaux, figures de champions, formes de présentation du spectacle sportif, etc. Au-delà, la mobilisation de méthodologies innovantes et adaptées au traitement de séries longues permettra de porter une attention toute particulière aux formes de l’écriture journalistique et à l’éventuelle identification d’un patrimoine linguistique commun qui viendrait s’agréger à l’ensemble des sphères de la « galaxie communiste », par-delà la seule presse. L’analyse lexicale et syntaxique, le traitement iconographique, la fouille de données, le comparatisme sont les principales méthodes retenues, en sus des formes traditionnelles de traitement des sources par l’historien. S’inscrivant dans une historiographie pionnière s’agissant de l’histoire de la presse sportive, ce projet offre l’occasion d’une réflexion ciblée sur les usages politiques d’un sport populaire emblématique, pour le temps contemporain.
![IRIS : Inventaire Rouge de l’Information Sportive »]() IRIS : Inventaire Rouge de l’Information Sportive »
IRIS : Inventaire Rouge de l’Information Sportive »
Read more
Responsable scientifique : Julie FEN-CHONG – Laboratoire THEMA – UMR CNRS-UB 6049 – Université Bourgogne Franche-Comté Partenaires : Laboratoire TIL/Centre Interlangues (EA 4182) – Université de Bourgogne, laboratoire ELLIADD (EA 4661 – Université de Franche-Comté) Financement : AAP TTP (« Travail, Transmission, Pouvoirs ») – MSH Dijon et MSH Besançon Durée : 8 mois Résumé du projet : Le projet #juratourisme a pour objectif de constituer et d’analyser un corpus de données issues de Twitter ayant trait au tourisme dans l’Arc jurassien. Une méthodologie générique d’extraction d’information géographique pertinente à partir des tweets collectés sera développée. Le corpus servira de support à l’analyse et la comparaison des discours et des pratiques touristiques de ces stations de montagne. Ce projet permettra enfin d’affiner la connaissance des synergies existant au sein de l’Arc jurassien. Le projet #juratourisme vise tout d’abord à analyser les représentations et pratiques touristiques des stations de montagne à partir des tweets des acteurs officiels et des visiteurs du Jura franco-suisse. Il s’agira ensuite de développer un outil de collecte, basé sur l’expérience de la plateforme ADN, et une méthodologie générique réutilisable pour d’autres territoires en adaptant les variables imposées par les particularités du terrain étudié. Enfin, il s’agira de contribuer à la diffusion de ces connaissances via la création d’un outil de visualisation de données sémantiques et spatialisées développées en collaboration entre les différents partenaires pour s’appuyer sur les connaissances développées par chacun : l’analyse textuelle et sémantique pour le laboratoire TIL, le web sémantique et les ontologies pour ELLIADD, l’interprétation géographique pour ThéMA et la visualisation des données par la plateforme GéoBFC de la MSH de Dijon. Le projet #juratourisme aura des retombées socio-économiques à plusieurs niveaux. Il engendrera dans un premier temps une mise en lumière des interdépendances de l’Arc jurassien. L’étude de la représentation des lieux d’intérêts des stations permettra également d’affiner les stratégies de développement touristique et en particulier offrira une meilleure visibilité des avantages offerts par le réseau social Twitter dans leur communication. Ces résultats seront valorisés par la participation à la journée d’études « L’Analyse des signaux et des traces produits par et pour les flux et mobilités touristiques », université Paris-Descartes, 14 sept. 2017 et la soumission d’un article pour la revue Espacestemps.net.
Discours et pratiques touristiques dans l’Arc Jurassien analysés au prisme des médias sociaux (JURATOURISME)
![JURATOURISME : Discours et pratiques touristiques dans l’Arc Jurassien analysés au prisme des médias sociaux]() JURATOURISME : Discours et pratiques touristiques dans l’Arc Jurassien analysés au prisme des médias sociaux
JURATOURISME : Discours et pratiques touristiques dans l’Arc Jurassien analysés au prisme des médias sociaux
Read more
Responsable scientifique : Dany LAPOSTOLLE – Laboratoire THEMA (UMR CNRS-uB 6049) – Université de Bourgogne Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR CNRS – Université de Bourgogne 3516) – Laboratoire THEMA (UMR CNRS-uB 6049) – Université de Bourgogne – Laboratoire CESAER (UMR 1041 – INRA-AGROSUP) – Ville de Tournus – Tournugeois Vivant – Association Economie Solidarité Partage (ESP) – Maison de Santé – Centre social – Initiative Santé citoyenne – café associatif – Maison des Femmes – Groupe local Tournugeois Terre de Liens – GFA Alternative. Financement : AAP POPSU Territoires 2020 Durée : 24 mois Résumé du projet : Cette recherche action est consacrée à Tournus, petite ville de 6 000 habitants située dans le département de Saône et Loire, en quête d’une nouvelle trajectoire de développement. Marquée depuis plus de 30ans, comme beaucoup d’autres petites villes, par une relative désindustrialisation, une perte et un vieillissement de population, elle s’inscrit désormais dans une logique de capacitation territoriale. Ce programme a pour ambition d’identifier ce qui, au sein du territoire, permet aux individus et à leurs collectifs de faire émerger et convertir des ressources locales matérielles et immatérielles en réalisations concrètes pour atteindre les buts de vie qu’ils se fixent. Ici les individus sont une fin, non un moyen au service du développement économique. Cette logique de capacitation se construit dans et par la démocratie alimentaire (Duboys de Labarre et al. 2016, Paturel et Ramel 2017), enjeu politique, économique, social et culturel de première importance (Darrot et Noel 2016, 2018) pour fédérer les initiatives citoyennes au sein de ce territoire (Zask 2016).
Ce projet de recherche action s’intègre au programme scientifique porté par le living lab d’innovation territoriale pour une transition socio écologique abrité par la MSH Dijon de l’Université de Bourgogne Franche Comté. Ce collectif ouvert aux institutions et associations regroupe une dizaine d’enseignants chercheurs qui s’intéressent aux questions de développement territorial par différentes entrées, leur point commun étant la démarche transdisciplinaire, définie comme une recherche action interdisciplinaire participative.Living Lab Territorial pour la Transition Écologique
![La démocratie alimentaire comme enjeu de capacitation territoriale]() La démocratie alimentaire comme enjeu de capacitation territoriale
La démocratie alimentaire comme enjeu de capacitation territoriale
Read more
Responsable scientifique : Martine CLOUZOT – Laboratoire ARTEHIS (Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés) (UMR CNRS-UB 6298). Partenaires : Parc Naturel Régional du Morvan (PNRM). Financement : FEDER – CRBFC Durée : 5 ans Résumé du projet : Ce projet s’articule autour d’une thèse en géohistoire « étude de la gestion des espaces et des contestations paysannes : le bocage et les forêts du Morvan, un patrimoine naturel et culturel en questions (XIIe-XXIe siècle) ». Il s’agit d’étudier les évolutions paysagères dans leur dimension socio-économique en s’intéressant au lien qu’elles entretiennent avec les statuts juridiques du foncier. Pour garantir la faisabilité du projet, le territoire d’étude a été limité à quelques communes du Haut-Morvan. Plusieurs espaces y sont observés dans la longue durée, en croisant les enseignements des textes, de l’archéologie, des sciences naturelles et de la géographie. Les régimes juridiques des espaces et leurs évolutions marquent les paysages. Ainsi, des traces du passé demeurent dans ces derniers. Par exemple, le poids du pâturage porcin a construit une part importante de l’identité et du peuplement de la forêt grâce à la sélection d’essences « portant fruits » que l’on retrouve dans les textes dès le Moyen Âge. L’objectif est de déceler dans les paysages des traces du passé tout en définissant les pratiques qui n’ont laissé aucune empreinte. La dernière phase du projet permettra à partir des enseignements de l’expérience historique, d’inventer et d’encourager de nouvelles formes de mises en valeur des espaces grâce au concours d’ingénieurs en environnement et agronomie. Ce travail s’intéressera notamment à développer des liens entre forestiers et éleveurs porcins. Au bout du compte, il s’agit de démontrer l’utilité de l’histoire pour comprendre l’actuel et construire la prospective à l’échelle d’un territoire en déprise que constitue le Morvan.
![La terre et la forêt en Morvan : l’histoire au service d’un territoire]() La terre et la forêt en Morvan : l’histoire au service d’un territoire
La terre et la forêt en Morvan : l’histoire au service d’un territoire
Read more
Responsable scientifique : Dany LAPOSTOLLE – Laboratoire de géographie – THEMA, antenne dijonnaise (UMR CNRS-UB 6049) Partenaires : DREAL Bourgogne Franche-Comté Financement : DREAL Bourgogne Franche-Comté Durée : 4 ans Résumé du projet : Le Living Lab territorial pour la transition sociale et écologique est un groupe de recherche transdisciplinaire porté par la MSH Dijon. Il est ouvert aux acteurs institutionnels, associatifs, et aux différents publics intéressés par les enjeux de la transition socio-écologique. Il est composé d’enseignants-chercheurs en économie territoriale, sociologie, aménagement et urbanisme, psychosociologie, histoire des sciences et techniques, sciences de l’éducation et de la formation rattachés à leurs laboratoires respectifs mais ayant une curiosité commune pour les enjeux de développement territorial. Le Living Lab territorial est né d’un partenariat entre la Dreal BFC et la Msh Dijon dans le cadre du programme « Bourgogne Franche-Comté en transition » (« BFC en transition ») issu d’un appel à projet du Commissariat Général au Développement Durable. Le Living Lab Territorial travaille dans le cadre de différents programmes : ANR Transitions Energétiques Territoires Hydrogène et Société (THETYS), BQR dispositif de recherche transdisciplinaire de type « Living Lab » (Tradli), Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu) pour le projet Démocratie alimentaire comme enjeu de capacitation territoriale avec la ville de Tournus. Les fonds Vidal Action de recherche du Cnrs complètent le financement. La définition générique du Living Lab est suffisamment souple pour abriter de multiples expérimentations tournées vers l’innovation technique et sociale. Sans céder à la rhétorique managériale que l’on retrouve parfois dans cet univers en réseau, connecté, composé de classes créatives pour réduire l’écart entre recherche et mise sur le marché, nous retenons la dimension méthodologique qui organise des collaborations entre des usagers, des chercheurs, des entreprises et/ou institutions publiques dans le but de définir et développer ensemble de nouveaux services, systèmes publics et communautaires tout en continuant l’exercice scientifique d’observation, questionnement méthodologique et interprétation des faits. Le Living Lab territorial pour une transition sociale et écologique opérationnalise la démarche transdisciplinaire. Il se construit comme un espace de problématisation d’une situation territoriale fondée sur les débats égaux entre chercheurs et acteurs. Cette problématisation suppose une supervision réciproque des intervenants pour anticiper et réduire les risques d’asymétries dans les relations d’analyse.
![Le Living Lab Territorial Pour La Transition Socio Ecologique]() Le Living Lab Territorial Pour La Transition Socio Ecologique
Le Living Lab Territorial Pour La Transition Socio Ecologique
Read more
Responsable scientifique : Anne JEGOU – Laboratoire THEMA (UMR CNRS-uB 6049) – Université de Bourgogne Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR CNRS – Université de Bourgogne 3516) – Laboratoire THEMA (UMR CNRS-uB 6049) – Université de Bourgogne – DREAL Bourgogne Franche-Comté Financement : AAP RITM 2020 Durée : 36 mois Résumé du projet : Les étudiants de géographie éprouvent des difficultés à identifier le millefeuille territorial français, les jeux d’acteurs et les enjeux de gouvernance. Jouer à un Serious Game améliorera leur capacité à opérer des arbitrages fin et décisifs dans la gouvernance environnementale et plus généralement leur sens politique. Le projet pédagogique vise la fabrication matérielle et numérique d’un Serious Game, son intégration dans un dispositif d’enseignement classique et son évaluation. Les étudiants seront observés dans leurs interactions et leur débriefing, une autoévaluation et une enquête leur seront proposés après le jeu puis à moyen terme. Compétences disciplinaires et compétences transversales seront tout autant évaluées. Ce projet pédagogique s’appuie sur un projet scientifique en cours visant à utiliser le même jeu auprès d’acteurs du territoire (élus et des professionnels de la gestion de sites patrimoniaux naturels).
![Les Serious Game pour comprendre la gouvernance et les jeux d’acteurs territoriaux]() Les Serious Game pour comprendre la gouvernance et les jeux d’acteurs territoriaux
Les Serious Game pour comprendre la gouvernance et les jeux d’acteurs territoriaux
Read more
Responsable scientifique : Sophie AYMES (Laboratoire TIL – Centre Interlangues – EA 4182 – UB) Partenaires : Laboratoire ELLIADD (EA 4661 – UFC) – Laboratoire THALIM (UMR 7172 – Université Paris 3) – Laboratoire ARTEHIS (UMR 6298 CNRS-UB) – Laboratoire IDEA (UR 2338 – Université de Lorraine) – Laboratoire CPTC (EA 4178 – UB) – Laboratoire DeScripto (UR 202023553U – Université Polytechnique des Hauts de France) – Laboratoire ILLE (UR 4363 – Université de Haute Alsace) – Faculté de traduction et d’interprétation (Université de Genève – Suisse). Financement : AAP TRANSLATION 2022 Durée : janvier – décembre 2022 Résumé du projet :
Le projet M-LIEN portera sur la circulation du livre illustré et des matériaux utilisés dans sa fabrication au sein de l’espace européen, des débuts de l’imprimerie moderne à la période contemporaine. Il s’agit d’un projet de recherche qui comporte une exploitation pédagogique, et qui est ancré dans trois domaines : histoire du livre et de l’imprimé ; écocritique et culture matérielle ; théories de l’illustration et de l’adaptation. Le livrable proposé est un MOOC intitulé Métamorphoses du livre (2 niveaux : Licence L2-L3 ; Master-Doctorat) s’inscrivant dans le renforcement des liens formation-recherche.
La recherche et l’enseignement portant sur le livre et l’illustration sont interdisciplinaires et transversaux par nature : au sein des SHS, l’étude du livre illustré concerne les historiens, les historiens de l’art, les civilisationnistes, les littéraires et comparatistes, les spécialistes de l’édition et des métiers du livre, de l’illustration, des médias et de la culture matérielle. Les spécialistes du livre sont amenés à travailler sur les réseaux transnationaux de diffusion et réception des textes, des illustrations, des traductions illustrées, ainsi que des technologies et savoir-faire, qui gouvernent la circulation des œuvres. La perspective théorique retenue ici a pour but de croiser les champs de l’histoire du livre, de l’écocritique et de l’adaptation (par le prisme de l’illustration notamment), et d’aborder ainsi la matérialité du livre d’une manière innovante.
Le projet M-LIEN s’inscrit donc dans la perspective adoptée par l’Axe TransLation puisque son objet d’étude et ses orientations théorique et pédagogique correspondent aux mots-clés « transfert », « circulation » et « transition » : objet à la fois stable et évolutif, le livre est un médium caractérisé par une grande adaptabilité aux changements culturels, médiaux et technologiques. Il perdure en se transformant et traverse les frontières. Sa circulation est liée à des processus de réécriture, remédiation, illustration et adaptation qui conjuguent mutation et transmission. Ils comportent des aspects matériels (désignés sous le terme générique de « fabrique du livre ») et immatériels (l’œuvre dans son sens désincarné, mais aussi les significations symboliques et médiales des matériaux utilisés). Ils peuvent être abordés d’un point de vue diachronique et synchronique, et donner lieu à des micro- comme à des macro-analyses.
![M-LIEN : Métamorphoses du LIvre et Environnement]() M-LIEN : Métamorphoses du LIvre et Environnement
M-LIEN : Métamorphoses du LIvre et Environnement
Read more
Responsable scientifique : Karen BRETIN-MAFFIULETTI (LIR3S – UMR CNRS-uB 7366) Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR 3516) – Centre Lucien Febvre (EA 2273 – UFC) – CREHS (UR 4027 – Université d’Artois) – CRULH (EA 3945 – Université de Lorraine) – CREDIMI (EA 7532 – UB). Financement : AAP TRANSLATION 2023 Durée : janvier – décembre 2023 Résumé du projet :
Le projet MIF porte sur l’étude de la représentation du football dans un mensuel proche du Parti communiste français, Miroir du football, publié entre 1958 et 1979. Une analyse des contenus du magazine, croisée avec des biographies de ses principaux journalistes, doit questionner l’appropriation par la presse « ouvrière » d’une pratique sportive dominante et bourgeoise, de par ses origines, mais aussi réputée comme l’une des plus populaires. Les observations effectuées pourront, in fine, être rapportées et comparées aux contenus d’autres titres consacrés au football (comme l’hebdomadaire France football) ou à d’autres « écritures communistes du sport » (comme celles mises en évidence dans Miroir du cyclisme : projet de recherche en cours, lauréat de l’AAP CollEx-Persée 2021-2022, qui sera conduit en 2023 et 2024).
Le projet MIF traite de la circulation et de la réception des cultures corporelles sportives au second XXe siècle, à travers une étude des discours médiatiques consacrés au football dans un magazine proche du Parti communiste français.
![MIF : Miroir du football : un autre sport dans la presse rouge ? (1958-1979)]() MIF : Miroir du football : un autre sport dans la presse rouge ? (1958-1979)
MIF : Miroir du football : un autre sport dans la presse rouge ? (1958-1979)
Read more
Responsable scientifique : Raphaël LAURIN (Laboratoire Psy-DREPI (EA 7458 – Université de Bourgogne) Partenaires : Laboratoire Psy-DREPI (EA 7458 – Université de Bourgogne) – Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR 3516 CNRSs-UB) – LE2I Institut Image (UMR 6306CNRS-UB) Financement : AAP RnMSH – MI – Projet Exploratoire Premier Soutien (PEPS) (2017) Durée : Février 2018 – Décembre 2019 Résumé du projet :
MVIV est un programme de recherche investissant le rôle des émotions sur les comportements en situation de menace identitaire à travers l’utilisation de technologies favorisant l’immersion dans des environnements virtuels. Ce projet de recherche vise à la fois la réplication en milieu virtuel de travaux précédemment réalisés en laboratoire et en milieu naturel et une extension de ces travaux à d’autres types de situations de menaces identitaires et d’émotions activées. En plus de présenter un intérêt heuristique et appliqué, ce projet s’inscrit dans une volonté de développer à court terme un dispositif de réalité virtuelle pouvant être déployé à partir de la MSH de Dijon à d’autres projets impliquant diverses disciplines de SHS.
L’objectif de ce projet de recherche est de mieux comprendre et anticiper chez les supporters, la réception des comportements antisportifs des athlètes sur le terrain. Plus spécifiquement, une approche de type expérimentale sera utilisée, s’appuyant sur une nouvelle technologie (la Réalité Virtuelle ; cf. partie suivante), afin de mesurer l’impact de différentes configurations émotionnelles sur la gestion des situations de menace identitaires chez les supporters. Les enjeux sociaux, politiques et économiques de ce projet seront de proposer des modalités de développement durable du spectacle sportif grâce à une gestion plus efficiente des comportements déviants, sur le terrain et dans les tribunes, à l’aide d’outils de diagnostic et de prévention.
![MVIV : Menace identitaire et violence intergroupe : une approche par la réalité virtuelle]() MVIV : Menace identitaire et violence intergroupe : une approche par la réalité virtuelle
MVIV : Menace identitaire et violence intergroupe : une approche par la réalité virtuelle
Read more
Responsable scientifique : Thomas THEVENIN – Laboratoire THEMA (UMR CNRS-uB 6049) – Université de Bourgogne Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR CNRS-uB 3516) – Laboratoire BIOGEOSCIENCES – Université de Bourgogne – Dijon Métropole. Financement : AAP Plateformes CRBFC 2021 Résumé du projet : Les réseaux MUSTARDijon et QameleON constituent un observatoire de la qualité environnementale, température et qualité de l’air, de Dijon Métropole. Cette infrastructure a bénéficié de 2 financements du CR-BFC et du CPER en2019 et 2020 pour faire évoluer ou développer ces réseaux vers un dispositif intelligent et validé scientifiquement. L’infrastructure a également permis, en 2019, de faire l’acquisition d’un dispositif de mesures mobiles de la pollution particulaire carbonée.
Durée : 36 mois
A ce jour 72 sondes de température, une dizaine de micro-stations QameleO (et 30 à horizon 2022) et un micro-aéthalomètre permettent de réaliser un monitoring environnemental à Dijon. L’information géographique étant au cœur de ce projet, la plateforme GEOBFC et ThéMA s’associent à CRC-Biogéosciences pour constituer cet observatoire de seconde génération s’inscrivant dans un ensemble de programmes d’échelles :
– régionale : SAVE-IFU, 2020-2021, financé par le Pôle fédératif en santé publique BFC et l’ADEME ;
– nationale : 1/ PURE, POPSU, 2019-2020, financé par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES) et Dijon Métropole et 2/ SNO OBSERVIL, INSU, CNRS et 3/ CNES Quali_ThR 2019-2021 ;
– européenne : RESPONSE, Dijon Métropole et Turku, Finlande, 2021-2025, financé par l’UE.
Ce projet OBS_AQ constitue une opportunité via l’acquisition d’un deuxième micro-aéthalomètre. Le premier permet la mesure des concentrations en particules carbonées (BC). Ce nouvel instrument permet de gagner en précision sur les concentrations mesurées mais surtout de fournir une nouvelle information sur les sources des particules carbonées.
![OBS_AQ : Observatoire Environnemental à Dijon ; investissement en qualité de l’air]() OBS_AQ : Observatoire Environnemental à Dijon ; investissement en qualité de l’air
OBS_AQ : Observatoire Environnemental à Dijon ; investissement en qualité de l’air
Read more
Responsable scientifique : Dany LAPOSTOLLE – Laboratoire THEMA – UMR CNRS-UB 6049 – Université Bourgogne Franche-Comté Partenaires : Laboratoire Psy-DREPI (EA – Université de Bourgogne), Laboratoire d’Economie de Dijon (LEDI) (EA 7467 – Université de Bourgogne), CESAER (Agrosup Dijon), Laboratoire des Sciences Historiques (LSH) (EA 2273 – Université de Franche-Comté), Ville de Longvic, Ville de Prémery, Communauté de communes Nièvre Forêt. Financement : AAP TTP (« Travail, Transmission, Pouvoirs ») – MSH Dijon et MSH Besançon Durée : 8 mois Résumé du projet : Ce projet est porté au sein du groupe thématique de recherche « Emploi et Territoire » de la MSH de Dijon. Il a pour objet l’analyse interdisciplinaire de trois dispositifs territoriaux pour l’emploi (territoire zéro chômage, Emergence, Cité de l’autre économie) dans quatre terrains d’études (Nièvre et forêt, Longvic, Dijon, Besançon). Suivant une méthode comparative, il produit de manière participative une grille d’évaluation des dispositifs concernés dans une perspective de capacitation des personnes sans emploi Ce projet fait suite à l’accompagnement par la recherche (par les chercheurs du groupe thématique de recherche « Emploi et Territoire » de la MSH de Dijon) du dispositif « Territoire Zéro Chômage de Longue Durée (TZCLD) » dans la commune de Longvic (21). L’objectif était d’observer l’impact de l’expérimentation sur le territoire, et les bénéfices obtenus aux plans humain et sociétal tout en définissant les conditions de son éventuelle généralisation. Il s’agit ici d’étendre les méthodes de travail interdisciplinaires à d’autres dispositifs pour l’emploi semblables. Sur cette base concrète, le programme se nourrit de l’observation d’une extension de l’économie de marché et conduit les chercheurs à construire une nouvelle façon de penser le travail et à engager une nouvelle critique de l’économie politique. L’enjeu est alors de mettre la recherche au service d’une nouvelle intelligence collective et d’un nouveau commerce social (Stiegler, 2009). Ce programme de recherche comporte trois objectifs fondamentaux : – compréhension des processus de mutation de l’emploi et des nouvelles relations à l’emploi ; – évaluation des dispositifs d’accompagnement et caractérisation des processus de gouvernance territoriale des projets ; – accompagnement de la recherche de solutions et création d’activité.
Observatoire Territorial des Initiatives d’Emploi
![Observatoire Territorial des Initiatives d’Emploi]() Observatoire Territorial des Initiatives d’Emploi
Observatoire Territorial des Initiatives d’Emploi
Read more
![PAPRIK@2F : Portail Archives Politiques Recherches Indexation Komintern et fonds français]() PAPRIK@2F : Portail Archives Politiques Recherches Indexation Komintern et fonds français
PAPRIK@2F : Portail Archives Politiques Recherches Indexation Komintern et fonds français
Read more
Responsable scientifique : Sylvie CRINQUAND – Laboratoire TIL/Centre Interlangues (EA 4182) – Université de Bourgogne Partenaires : MSH Dijon (Plateforme ADN) Financement : AAP TTP (« Travail, Transmission, Pouvoirs ») – MSH Dijon et MSH Besançon Durée : 8 mois Résumé du projet : Ce projet vise à interviewer des chercheur.e.s reconnu.e.s (dont Henri Joyeux, Carlo Ossola, professeur au collège de France, François Jullien) sur leur itinéraire, la place de la recherche dans leur vie, et l’interprétation qu’ils font de leurs choix en matière de recherche. Les enregistrements seront retranscrits, le corpus audio (visuel) sera indexé et annoté selon les standards internationaux, puis archivé et diffusé en libre accès sur la plateforme PANDOR de la MSH. L’objectif est de s’intéresser à une partie de la recherche qui n’a toujours pas été étudiée de manière systématique à l’échelle interdisciplinaire. Si des études existent sur l’autobiographie des chercheurs, notamment en sociologie, et si certaines disciplines incluent la réflexion sur le parcours personnel dans des dossiers d’HDR, d’autres ignorent ou gomment la part personnelle de la recherche. Notre travail cherche à remédier à cette lacune, afin de mieux comprendre la part que joue l’individuel dans la démarche des chercheur.e.s. Il s’inscrit dans une dynamique résolument interdisciplinaire, afin de dépasser les clivages disciplinaires. En termes de diffusion des résultats, il est prévu : la publication d’un ouvrage grand public, la réalisation d’une exposition ainsi que la diffusion des enregistrements via PANDOR.
![PARCHEMINS : Paroles de chercheur.e.s : dans l’intimité de la recherche]() PARCHEMINS : Paroles de chercheur.e.s : dans l’intimité de la recherche
PARCHEMINS : Paroles de chercheur.e.s : dans l’intimité de la recherche
Read more
Responsable scientifique : Agnès ALEXANDRE-COLLIER – Laboratoire TIL/Centre Interlangues (EA 4182) – Université de Bourgogne Partenaires : CREDESPO (Centre de Recherche et d’Etude en Droit et Science Politique – EA 4179) – Université de Bourgogne / CRJFC (Centre de recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté – EA 3225) – Université de Franche-Comté Financement : AAP TTP (« Travail, Transmission, Pouvoirs ») – MSH Dijon et MSH Besançon Durée : 8 mois Résumé du projet : Le projet a pour objectif d’appr/éhender le renouvellement et la valorisation de la participation des citoyens à la prise de décision collective au sein des organisations politiques et sociales. Il s’agit de de s’intéresser plus précisément à l’implication des citoyens dans les modes de sélection des cadres ou des principaux acteurs et dans le choix des propositions que porteront ceux-ci. Le projet vise à comprendre et décrypter le renouvellement et la valorisation de la participation des citoyens à la prise de décision collective. Il étudiera le développement des formes de participation citoyenne dans les modes de sélection relatif aux organisations politiques (partis, mouvements ou groupes de pression) et de s’intéresser aux modes de sélection des cadres ou des principaux acteurs (responsables, candidats aux élections,…) et au choix des propositions et thématiques portées par les organisations politiques et sociales (partis, associations, groupes d’intérêts). Cette étude renvoie à l’invention et à l’usage par ces organisations de procédures diverses : primaires fermées ou ouvertes, consultations Internet, référendums internes, et autres formes de délibération collective afin de répondre à la crise de légitimité des formes de représentation ou de délégation classiques. Le projet privilégiera une dimension comparative à la fois au plan international (France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Espagne,…) et régionale (Bourgogne, Franche-Comté notamment).
La participation citoyenne à la prise de décision politique (PARCIT)
![PARCIT : la participation citoyenne à la prise de décision politique]() PARCIT : la participation citoyenne à la prise de décision politique
PARCIT : la participation citoyenne à la prise de décision politique
Read more
Responsable scientifique : Luz MARTINEZ (Laboratoire TIL – Centre Interlangues – EA 4182 – UB) Partenaires : Laboratoire CRIT (EA3224 – UFC) – Laboratoire ERIAC (EA 4705 – Université Rouen Normandie) – Laboratoire LIB (EA 7534 – UB). Financement : AAP TRANSLATION 2022 Durée : janvier – décembre 2022 Résumé du projet :
Le projet PESACA vise, à travers l’entraînement d’un modèle de post-édition, à améliorer la qualité des sorties de systèmes de traduction automatique neuronale en français langue de spécialité, en prenant comme cas d’usage pilote le domaine agroalimentaire. Il s’inscrit dans la circulation des savoirs et des idées spécialisés puisque le modèle visé enrichira les processus et les mécanismes de transfert linguistique, en intégrant des données linguistiques issues de discours spécialisés rédigés en langue naturelle française.
Le projet PESACA se situe à l’intersection de trois mots-clés de l’axe TransLation dans la mesure où les actions visent, d’une part, la « circulation » et le « transfert » des informations issues d’un domaine de spécialité et de l’autre, la « transition » technologique vers le Web sémantique.
![PESACA : Post-édition semi-automatique à partir d’un corpus agroalimentaire]() PESACA : Post-édition semi-automatique à partir d’un corpus agroalimentaire
PESACA : Post-édition semi-automatique à partir d’un corpus agroalimentaire
Read more
Responsable scientifique : Henri GARRIC – Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures – CPTC (EA 4178 – UB) Partenaires : LIR3S (UMR CNRS-uB 7366) – Centre Lucien Febvre (EA2273 – UFC) – C3S (UR 4660 – UFC) – SCD (Université Bordeaux-Montaigne) – Centre de Recherche en Histoire du XIXème (UR 3550 – Lettres Sorbonne Université – Arts et Médias (Paris 3). Financement : AAP TTP 2018 (Fédération des MSH Bourgogne Franche-Comté) Durée : 1 an Résumé du projet : Le projet PIFERAI se propose de remettre en lumière l’importance de la série « Pif le chien » parue dans les années 1950 et 1960 dans L’Humanité et Vaillant. Il articule une dimension esthétique (étude de la bande dessinée) et une dimension sociale, historique et politique : en posant la question de la place dans un « art mineur », des questions politiques et sociétales majeures, il veut comprendre les mécanismes de transmission dans les milieux populaires et proches du PCF de l’après-guerre.
![PIFERAI : Pif dans tous ses états : recherches, archives, interdisciplinarité]() PIFERAI : Pif dans tous ses états : recherches, archives, interdisciplinarité
PIFERAI : Pif dans tous ses états : recherches, archives, interdisciplinarité
Read more
Responsable scientifique : Hervé MARCHAL (LIR3S – UMR CNRS-UB 7366) et Directeur de la MSH de Dijon (UAR CNRS-UB 3516) Partenaires : Dijon Métropole – GIP L’Europe des projets architecturaux et urbains (EPAU) – THEMA (UMR CNRS-UB 6049) – CPTC (Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures) – LIR3S (Laboratoire interdisciplinaire de recherche Sociétés, sensibilités et soins, UMR CNRS 7366) – Biogéosciences (UMR CNRS 6282) – IRTESS de Bourgogne (Institut régional supérieur du travail éducatif et social) – EPHE (Ecole Pratique des Hautes Etudes – Université Paris Sciences et Lettres). Financement : POPSU Transition (Dijon Métropole – GIP L’Europe des projets architecturaux et urbains (EPAU)). Durée : 2024-2026 Résumé du projet : ce programme de recherche entend questionner les tenants et les aboutissants d’une métropole en transition définie comme une manière de faire raisonner les politiques publiques et les pratiques habitantes liées à la transition écologique. À partir de multiples terrains de recherche investis par des chercheurs issus de différentes disciplines, l’ambition est in fine de penser, voire de développer, les interactions entre les évolutions concrètes des modes de vie et les politiques publiques mises en place ou à venir. Il s’agit d’étudier comment mieux appréhender, objectiver, l’influence réciproque entre les politiques publiques et les modes de vie, et ce, afin de mieux renforcer notre capacité collective à relever les défis de la transition ? Ce programme vise ainsi trois objectifs :
Dijon métropole a souhaité ici porté à la 4e édition du programme POPSU Transitions ce sujet de la circularité entre les modes de vie et les politiques publiques, dans le contexte actuel de transitions, en mettant l’accent plus particulièrement sur les « chemins » qu’il convient d’emprunter pour penser ces transitions, les diffuser et les réaliser.
![POPSU Transitions : Dijon Métropole – Penser les tenants et les aboutissants d’une métropole en transition : circularité entre modes de vie et politiques publiques]() POPSU Transitions : Dijon Métropole – Penser les tenants et les aboutissants d’une métropole en transition : circularité entre modes de vie et politiques publiques
POPSU Transitions : Dijon Métropole – Penser les tenants et les aboutissants d’une métropole en transition : circularité entre modes de vie et politiques publiques
Read more
Responsable scientifique : Dany LAPOSTOLE – Laboratoire THEMA (UMR CNRS-uB 6049) – Université de Bourgogne Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR CNRS – Université de Bourgogne 3516) – Laboratoire THEMA (UMR CNRS-uB 6049) – Université de Bourgogne – École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs – Entreprise à But d’Emploi 58 – Association Les Ateliers Nomades – Association Économie Solidarité Partage – Association In’Terre ActiV – DREAL Bourgogne Franche-Comté Financement : AAP ADEME – DREAL Résumé du projet : Le projet PREFIGS du Living-lab Territorial pour la Transition Écologique propose une démarche transdisciplinaire pour enquêter sur les expériences de vies précaires (santé, chômage, alimentation, vie dans les quartiers populaires) éprouvées dans quelques territoires ruraux, petites villes et villes moyennes de Bourgogne Franche-Comté. Constatant le schisme de réalité entre la montée des périls environnementaux déjà trop bien informés sur leurs causes et effets, et la gouvernance top down des actions pour les maîtriser, nous posons que la combinaison des savoirs et des formes organisationnelles aux méthodes et connaissances académiques est une piste à envisager pour proposer des trajectoires territoriales de transitions par le bas se départissant des ontologies dualistes et du solutionnisme technologique.
Durée : 24 mois
![PREFIGS : PRécarité Écologie Futur Imaginaires orGanisations Savoirs]() PREFIGS : PRécarité Écologie Futur Imaginaires orGanisations Savoirs
PREFIGS : PRécarité Écologie Futur Imaginaires orGanisations Savoirs
Read more
Responsable scientifique : Dany LAPOSTOLLE – Laboratoire de géographie – THEMA, antenne dijonnaise (UMR CNRS-UB 6049) Partenaires : DREAL Bourgogne Franche-Comté Financement : DREAL Bourgogne Franche-Comté Durée : 4 ans Résumé du projet : Le Living Lab territorial pour la transition sociale et écologique est un groupe de recherche transdisciplinaire porté par la MSH Dijon. Il est ouvert aux acteurs institutionnels, associatifs, et aux différents publics intéressés par les enjeux de la transition socio-écologique. Il est composé d’enseignants-chercheurs en économie territoriale, sociologie, aménagement et urbanisme, psychosociologie, histoire des sciences et techniques, sciences de l’éducation et de la formation rattachés à leurs laboratoires respectifs mais ayant une curiosité commune pour les enjeux de développement territorial. Le Living Lab territorial est né d’un partenariat entre la Dreal BFC et la Msh Dijon dans le cadre du programme « Bourgogne Franche-Comté en transition » (« BFC en transition ») issu d’un appel à projet du Commissariat Général au Développement Durable. Le Living Lab Territorial travaille dans le cadre de différents programmes : ANR Transitions Energétiques Territoires Hydrogène et Société (THETYS), BQR dispositif de recherche transdisciplinaire de type « Living Lab » (Tradli), Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu) pour le projet Démocratie alimentaire comme enjeu de capacitation territoriale avec la ville de Tournus. Les fonds Vidal Action de recherche du Cnrs complètent le financement. La définition générique du Living Lab est suffisamment souple pour abriter de multiples expérimentations tournées vers l’innovation technique et sociale. Sans céder à la rhétorique managériale que l’on retrouve parfois dans cet univers en réseau, connecté, composé de classes créatives pour réduire l’écart entre recherche et mise sur le marché, nous retenons la dimension méthodologique qui organise des collaborations entre des usagers, des chercheurs, des entreprises et/ou institutions publiques dans le but de définir et développer ensemble de nouveaux services, systèmes publics et communautaires tout en continuant l’exercice scientifique d’observation, questionnement méthodologique et interprétation des faits. Le Living Lab territorial pour une transition sociale et écologique opérationnalise la démarche transdisciplinaire. Il se construit comme un espace de problématisation d’une situation territoriale fondée sur les débats égaux entre chercheurs et acteurs. Cette problématisation suppose une supervision réciproque des intervenants pour anticiper et réduire les risques d’asymétries dans les relations d’analyse.Living Lab Territorial pour la Transition socio-écologique
![Préfiguration d’un dispositif de recherches et démarches participatives de type « Living Lab » (ou « Laboratoire d’Innovation Territorial »)]() Préfiguration d’un dispositif de recherches et démarches participatives de type « Living Lab » (ou « Laboratoire d’Innovation Territorial »)
Préfiguration d’un dispositif de recherches et démarches participatives de type « Living Lab » (ou « Laboratoire d’Innovation Territorial »)
Read more
Responsable scientifique : Clémentine HUGOL-GENTIAL (CIMEOS) – Université de Bourgogne Partenaires : Financement : Durée : 10 ans Résumé du projet : (15 lignes maxi) https://www.metropole-dijon.fr/Grands-projets/Transition-alimentaire-ProDij
Laboratoire CIMEOS – MSH de Dijon (UAR CNRS – Université de Bourgogne 3516) – CSGA – Centre des sciences du Goût et de l’Alimentation (Université de Bourgogne) – ProDij – Eduter – Région Bourgogne Franche-Comté – Citoyens & Compagnie – Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine Mondial – CCI Côte-d’Or – Chambre des Métiers et de l’Artisanat – Bourgogne
Côte d’Or – Le Département – Agricultures & Territoires – Chambres d’Agriculture – AG Datahub – Atol – Conseils & Développements – B & Co – Arvalis – Institut du végétal – Ademe – Terre Azur – Groupe Pomona – CHU Dijon Bourgogne – Dijon Métropole – Ville de Dijon – Passion Froid – Agaric-IG – Agronov – Pôle d’innovation en agroécologie – Banques Alimentaires – Epi’Sourire – Institut Agro Dijon – UBFC – Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts – Contrat de Transition Ecologique – Aveine – Eveil o goût – Linkcity – Programme Malin pour bien grandir – CEN – Université Lyon 3 – Jean Moulin – Dijon Céréales – Campus des Métiers et des Qualifications – Alimentation, goût, tourisme – Bourgogne Franche-Comté – Cesaer- La maison Phare – Groupe Roullier – Elzeard – Yumain – Kura
Le repas gastronomique des Français – Patrimoine de l’Humanité – INRAE – Psy Drepi – Creativ – Epimut – Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin – Muséum National d’Histoire Naturelle – Vitagora – Sayens – Université de Bourgogne – INRA – Science & Impact – Groupe SEB – PAM – Food and wine Sciences & Technology.
Dijon Métropole
Région Bourgogne Franche-Comté
Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts)
Territoires d’Innovation – France 2030
![ProDij : Dijon, Alimentation durable 2030]() ProDij : Dijon, Alimentation durable 2030
ProDij : Dijon, Alimentation durable 2030
Read more
Coordinateur scientifique : Christian Salles, CSGA (UMR 1324) Partenaires : CSGA (UMR 1324) – SAYFOOD (UMR 0782) – UMR PAM – CESAER (UMR 1041) – CIMEOS (EA4177) – Terres Univia – Bouvard Alina Industries. Responsable scientifique du WP6 : Clémentine HUGOL-GENTIAL (Laboratoire CIMEOS– EA 4177 – UB) Chercheur.es impliquées dans le WP6 : Estera Badau, Fabien Bonnet, Aude Chauviat, Cyril Masselot (Laboratoire CIMEOS– EA 4177 – UB) Financement : AAP ANR France 2023 – Projet-LEG France 2030 Durée : 60 mois (5 ans) Résumé du projet : Les légumineuses ont de nombreux avantages pour l’alimentation humaine et l’environnement, et sont considérées essentielles pour atteindre une alimentation plus saine et plus durable, et assurer la sécurité alimentaire pour tous. Malgré ces atouts, leur consommation en France est très inférieure à la consommation moyenne mondiale. Les agriculteurs sont confrontés à des défis techniques et économiques pour diversifier leurs cultures en faveur des légumineuses. L’augmentation des légumineuses dans l’alimentation humaine ne doit pas reposer uniquement sur l’utilisation de protéines de légumineuses utilisées en tant qu’ingrédients dans des produits ultra-transformés. C’est la consommation de légumineuses en tant que produit alimentaire qui doit être encouragée. Ainsi, une transformation légère, qui rend les légumineuses à la fois faciles à préparer et acceptables pour les consommateurs, semble être la pierre angulaire de l’amélioration de l’acceptation et de l’adoption des légumineuses. L’objectif de PULSE FICTION est de développer des produits peu transformés à base de légumineuses qui répondent aux attentes des citoyens-mangeurs et des agriculteurs, et ont un faible impact environnemental. PULSE FICTION permet non seulement de sélectionner des produits qui répondent aux attentes des citoyens-mangeurs, aux contraintes des agriculteurs et aux questions de durabilité, mais aussi de comprendre les propriétés qu’un produit devrait avoir pour être cognitivement et sensoriellement acceptable. Pour finir, des messages destinés à accompagner l’appropriation des solutions innovantes à base de légumineuses seront développés et leur compréhension et réception par les citoyens-mangeurs seront vérifiées. Ces questions sont abordées par un consortium pluridisciplinaire. Le projet associe des approches innovantes issues des sciences humaines et sociales (CSGA, CESEAR), de l’évaluation sensorielle (SayFood, CSGA), de la chimie (CSGA, Bouvard), de la caractérisation d’analyse de cycle de vie (PAM, LAE) et de la communication (CIMEOS, Terres Univia).
![PULSE FICTION : Développement d’aliments peu transformés et de recettes à base de légumineuses pour répondre aux besoins des consommateurs et de la filière, et améliorer la durabilité des aliments.]() PULSE FICTION : Développement d’aliments peu transformés et de recettes à base de légumineuses pour répondre aux besoins des consommateurs et de la filière, et améliorer la durabilité des aliments.
PULSE FICTION : Développement d’aliments peu transformés et de recettes à base de légumineuses pour répondre aux besoins des consommateurs et de la filière, et améliorer la durabilité des aliments.
Read more
Responsable scientifique : Thomas THEVENIN – Laboratoire THEMA (UMR CNRS-uB 6049) – Université de Bourgogne
![PURE : Plateforme Urbaine d’Expérimentation de Dijon Métropole/La ville durable à l’épreuve de la ville intelligente]() PURE : Plateforme Urbaine d’Expérimentation de Dijon Métropole/La ville durable à l’épreuve de la ville intelligente
PURE : Plateforme Urbaine d’Expérimentation de Dijon Métropole/La ville durable à l’épreuve de la ville intelligente
Read more
Responsable scientifique : Edith SALES-WUILLEMIN (Laboratoire PSY-DREPI – EA7458 – UB) Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme Dijon (UAR 3516 – CNRS-UB) – Laboratoire PSY-DREPI (EA7458 – UB) – Laboratoire de Psychologie (EA 3188 – UFC) – Laboratoire LP3C, Laboratoire de Psychologie : cognition, comportement, Communication (EA1285 – Rennes 2) – Centre d’études sur les Innovations sociales CRISES (UQAM – Canada) Financement : AAP TTP (2019-2020) Durée : Février 2020 – Décembre 2020 Résumé du projet :
Le projet QUALTRA-SCALE concerne la construction et la validation d’une échelle (questionnaire) de qualité de vie au travail (QVT) auprès d’un échantillon de salariés (N=1000). La QVT sera décomposée en 7 dimensions, et mesurée au niveau perçu (ressenti) et attendu (souhaité), elle sera croisée avec des variables psycho-sociologiques (motivation, satisfaction, implication, stress perçu). L’échelle sera diffusée en ligne, grâce à la plateforme Qualtrics. A terme, une application smartphone et tablette sera créée.
Le questionnaire QUALTRA-SCALE est un outil de diagnostic de la santé et des risques psychosociaux au travail, qui permet d’accompagner les mécanismes de décision de la gouvernance et d’introduire de nouvelles pratiques dans le management des organisations de travail.
![QUALTRA-SCALE : QUAlité de Vie au TRAvail, validation d’une échelle de mesure]() QUALTRA-SCALE : QUAlité de Vie au TRAvail, validation d’une échelle de mesure
QUALTRA-SCALE : QUAlité de Vie au TRAvail, validation d’une échelle de mesure
Read more
Responsable scientifique : Jérôme BERTHAUT – Laboratoire CIMEOS (EA 4177) – Université de Bourgogne Partenaires : laboratoire RECITS-IRTES (EA 7274) – Université de Franche-Comté Financement : AAP TTP (« Travail, Transmission, Pouvoirs ») – MSH Dijon et MSH Besançon Durée : 8 mois Résumé du projet : ce projet vise à étudier l’évolution des dynamiques et des logiques de fonctionnement du secteur audiovisuel à l’ère numérique en s’appuyant sur une enquête ethnographique qualitative centrée sur les éditeurs de contenus (sociétés de production, youtubers, agences de presse) dans deux secteurs spécifiques : le journalisme et le divertissement. Ce projet analyse les pratiques professionnelles et la division du travail dans la production audiovisuelle à l’ère numérique pour cerner les rapports de pouvoir entre les fabricants de programmes et les diffuseurs dans un contexte de concurrence, et leurs effets sur les discours produits (circulation des idées, discrimination).
Reconfiguration de l’audiovisuel à l’ère numérique : agences de presse et youtubers (RANAPY)
![RANAPY : Reconfiguration de l’audiovisuel à l’ère numérique : agences de presse et youtubers]() RANAPY : Reconfiguration de l’audiovisuel à l’ère numérique : agences de presse et youtubers
RANAPY : Reconfiguration de l’audiovisuel à l’ère numérique : agences de presse et youtubers
Read more
Responsable scientifique : Fabrice MONNA (Laboratoire ARTEHIS – UMR CNRS-UB 6298) Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR 3516 CNRS-UB) – Laboratoire ARTEHIS (UMR CNRS-UB 6298) – Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco – Laboratoire Biogéosciences (UMR CNRS-UB 6383) – Institut de Mathématiques de Bourgogne (IMB) (UMR CNRS-UB 5584) – Institut de recherche en langue, littérature et en histoire – République de Khakassie, Abakan (Russie). Financement : AAP RNMSH-FMSH-TGIR HN (2018-2019) Durée : Février 2019 – Août 2020 Résumé du projet :
La steppe mongole recèle de structures archéologiques funéraires datant de l’âge du Bronze, qui sont le plus souvent accompagnées d’emblématiques monuments ornés, communément appelés « pierres à cerfs ». Comprendre l’organisation de ces structures, mais aussi l’organisation des symboles gravés sur les monuments, est une tâche délicate compte tenu de leur nombre et de leur variété. L’objectif du présent projet, résolument interdisciplinaire, est de développer une méthodologie basée sur les avancées récentes dans plusieurs domaines liés au traitement de la donnée (machine learning, deep learning, computer vision, geometric morphometrics, market basket…), notamment lorsqu’elle est trop abondante pour être abordée par des méthodes traditionnelles. L’application de ces récents développements techniques apportera un cadre quantitatif solide pour comprendre l’organisation spatiale des monuments et symboles, ainsi que leurs évolutions dans le temps. En croisant les différentes informations obtenues, il sera possible d’appréhender l’ordre syntaxique qui régit l’art de la culture des pierres à cerfs, ses régularités, mais aussi ses évolutions à travers le temps, ou à la suite d’interactions entre peuples nomades.
![ROSAS : Régularité dans l’Organisation des Structures Archéologiques et des Symboles gravés. Exemple de la Mongolie]() ROSAS : Régularité dans l’Organisation des Structures Archéologiques et des Symboles gravés. Exemple de la Mongolie
ROSAS : Régularité dans l’Organisation des Structures Archéologiques et des Symboles gravés. Exemple de la Mongolie
Read more
Responsable scientifique : Clémentine HUGOL-GENTIAL (CIMEOS) – Université de Bourgogne Partenaires : Laboratoire CIMEOS (porteur du WP4) (Université de Bourgogne) – CSGA INRAE Dijon (porteur de l’ANR) – GENIAL Ingénierie Procédés Aliments – C.E.R.T.O.P CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE TRAVAIL, ORGANISATION, POUVOIR, Université de Toulouse – QuaPA Qualité des Produits Animaux – INRAE Clermont-Ferrand Durée : 48 mois Résumé du projet :
Financement : AAP ANR 2019
Limiter l’apport en sodium a été identifié comme un levier efficace pour prévenir les maladies chroniques comme par exemple les maladies cardio-vasculaires. Cependant, l’apport en sodium par l’alimentation reste en moyenne deux fois plus élevé que le niveau recommandé par les organisations de santé publique. Les principales sources de sodium comprennent les produits alimentaires fabriqués industriellement mais aussi le sel « de table » ajouté par les consommateurs lors de la préparation des repas et à table lors de l’assaisonnement. Selon certaines études, le sel de table est une source qui peut contribuer à jusqu’à 30% de l’apport total en sodium. Pour autant, cette source a largement été négligée jusqu’ici bien qu’elle doive être considérée comme un levier pour poursuivre les efforts visant à réduire l’apport en sodium via l’alimentation. Le projet collaboratif Sal&Mieux fédère l’expertise de 5 partenaires académiques pour étudier de manière holistique comment optimiser et limiter l’utilisation du sel de table, tout en le rendant plus efficace pour maintenir le goût salé et l’appréciation des aliments. Ce Globalement, le projet de recherche Sal&Mieux vise à aider le consommateur à réduire ses apports en sodium en lui proposant, non pas seulement de limiter sa consommation de sel de table, comme c’est le cas aujourd’hui dans les campagnes de sensibilisation, mais en lui fournissant des conseils éprouvés lui permettant d’utiliser plus efficacement le sel de table, et ainsi contribuer à ses attentes en termes de gout et d’habitudes culinaires, tout en préservant durablement sa santé et son bien-être.
![Sal&Mieux : Optimiser l’usage du sel de table]() Sal&Mieux : Optimiser l’usage du sel de table
Sal&Mieux : Optimiser l’usage du sel de table
Read more
Responsable scientifique : Lucie FINEZ (PSY-DREPI – EA7458 – UB) Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR 3516) – Laboratoire LEAD (UMR CNRS-uB 5022) – ENSAM, Chalon sur Saône – CAPS Dijon – Plateforme Exercices Performance Santé Innovation (EPSI), Besançon – Opération Enthousiasme Orthographique (Cellule Cardie, circonscription Le Creusot-Autun) – Société Pas à Pas Innovation – Dweck-Walton Lab (Université de Stanford, Californie, USA) – Laboratoire travaillant de Psychophysiologie (German Sport University – Cologne – Allemagne) – Conseil Scientifique de l’Education Nationale (CSEN) Financement : AAP BQR UB 2021 Durée : janvier – décembre 2021 Résumé du projet :
La maîtrise de l’expression écrite et de l’orthographe est une problématique nationale, et ce pour les populations de tous âges. Quels sont les freins à l’engagement vers la maitrise de d’orthographe ? Si la cause est identifiée, des interventions ciblées pourraient être mises en place (Yeager et al., 2019). S’agit-il d’une surestimation de ses propres capacités, d’un déni de l’importance de l’orthographe, d’une démotivation ou de peur de l’échec ? Il est difficile de savoir ce qui se passe dans la tête d’une personne confrontée à une tâche mettant en jeu l’orthographe. Une personne qui pose son regard sur un écrit peut aussi bien être concentrée à le relire qu’à regarder la feuille sans intention particulière. Des outils récents développés en sciences cognitives et en physiologie permettent désormais d’estimer de façon fiable l’engagement et le désengagement mental. Nous proposons d’utiliser ces outils pour mesurer de façon fiable et en temps réel l’engagement sur les tâches d’orthographe. Les facteurs situationnels et personnels favorisant l’engagement dans les tâches d’orthographe seront étudiés.
![SCRIBE MINDSET : Maitriser l’orthographe : croyances implicites (mindset), engagement et désengagement]() SCRIBE MINDSET : Maitriser l’orthographe : croyances implicites (mindset), engagement et désengagement
SCRIBE MINDSET : Maitriser l’orthographe : croyances implicites (mindset), engagement et désengagement
Read more
Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR CNRS – Université de Bourgogne 3516) – Centre Interlangues TIL (EA 4182) – Université de Bourgogne – EPNAK – SYSTRAN – LUTIN USERLAB Financement : Contrat de collaboration de recherche / Etude de recherche et développement Durée : 3 mois Résumé du projet : l’EPNAK a souhaité mettre en place, sous la direction scientifique de Laurent Gautier, une collaboration avec la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, en particulier sa plateforme Humanités Numériques/pôle ADN (Archives – Documentation –Numérisation), pour tester l’implémentation du modèle de la sémantique des cadres (frame semantics, par la suite SdC) dans les procédures de simplification de contenus et ses potentialités d’automatisation en lien avec la plateforme développée dans le projet SIMPLES.
Les travaux réalisés :
– Compilation et livraison par l’EPNAK d’un corpus représentatif pour ses publics de textes instructionnels non-simplifiés ;
– Identification du moule textuel sous-jacent ;
– Identification des frames constitutifs ;
– Annotation systématique des frames avec identification (en lien avec l’expert/le praticien) des valeurs/relations par défaut ;
– Annotation des réalisations morphosyntaxiques prototypiques des fil/ers du frame et étalonnage de leur degré de complexité en termes d’accessibilité cognitive.
– Réintroduction des valeurs par défaut quand elles sont nécessaires ;
– Encodage des valeurs par défaut dans une phrase simple ;
– Ré-encodage des constituants du frame décompactés dans la phase précédente avec alignement sur les règles de FALC.
![SIMPLES : Facile à lire et à comprendre (FALC) à destination de publics présentant des déficiences cognitives, et visant à faciliter la traduction automatique et humaine ainsi que la rédaction de documents en FALC]() SIMPLES : Facile à lire et à comprendre (FALC) à destination de publics présentant des déficiences cognitives, et visant à faciliter la traduction automatique et humaine ainsi que la rédaction de documents en FALC
SIMPLES : Facile à lire et à comprendre (FALC) à destination de publics présentant des déficiences cognitives, et visant à faciliter la traduction automatique et humaine ainsi que la rédaction de documents en FALC
Read more
Responsable scientifique : Thomas THEVENIN – Laboratoire THEMA (UMR CNRS-uB 6049) – Université de Bourgogne Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR CNRS – Université de Bourgogne 3516) – Laboratoire THEMA (UMR CNRS-uB 6049) – Université de Bourgogne – I2M (INSTITUT DE MECANIQUE ET D’INGENIERIE DE BORDEAUX) – LIG (Laboratoire d’Informatique de Grenoble) – IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse). Financement : Appel à projets générique ANR 2018 (PRC – Projets de recherche collaborative) / Mobilité et systèmes urbains durables Durée : 48 mois Résumé du projet : Les infrastructures de transport participent à la définition de ce que sera la ville de demain (smart, durable et résiliente). Elles doivent compter avec l’émergence des nouvelles technologies (voitures autonomes et électriques, internet des objets, etc.) et la diversification des modalités de transport et l’évolution des pratiques (augmentation de la multi-modalité, voitures partagées, etc.). Une bonne prise en compte de ces aspects peut favoriser et accélérer la transition vers la ville du futur avec un impact social, environnemental et économique positif afin de faire face aux évolutions prévisibles du contexte (changement climatique, nouvelles contraintes en termes de pollution, sécurité, environnement, coût global, etc.). Le projet SwITCh vise à aider à l’aménagement urbain en simulant l’introduction progressive d’innovations relatives aux infrastructures (technologie, usage, comportement, etc.). Cela nécessite de concevoir un modèle capable d’évaluer les impacts de ces innovations sur des indicateurs clefs de mobilité, de qualité de service, de sécurité, de coûts économiques et de pollution. SwITCh utilise la modélisation multi-agent (ABM) et la simulation participative comme cadre unificateur pour coupler différents modèles et différentes échelles, tant temporelles que spatiales, afin de construire un modèle holistique. Il disposera d’un modèle de la ville basé sur des données SIG et d’un modèle réaliste de comportement de la population. Suivant une approche participative pour la modélisation et la simulation, l’outil sera conçu comme un support pour la consultation et la discussion permettant d’aider les différents acteurs, depuis le décideur jusqu’au citoyen, à construire un projet commun pour améliorer les infrastructures afin de répondre au défi de la ville de demain.
![SwITCh : Simuler la transition des infrastructures de transport jusqu’à la ville durable et intelligente]() SwITCh : Simuler la transition des infrastructures de transport jusqu’à la ville durable et intelligente
SwITCh : Simuler la transition des infrastructures de transport jusqu’à la ville durable et intelligente
Read more
Responsable scientifique : Jean-Philippe ANTONI – Laboratoire THEMA (UMR CNRS-uB 6049) – Université de Bourgogne Partenaires : Laboratoire THEMA (UMR CNRS-uB 6049) – Université de Bourgogne – Centre Interprofessionnel Technique Etude Pollution Atmosphérique (CITEPA) – Laboratoire d’Electronique, Antennes et Télécommunications (LAET) (coordinateur) – Université Côte d’Azur. CTRE INTERPROF TECH ETUDE POLLUT ATMOSP, Financement : AAP ADEME – APR TEES 2021 Durée : 30 mois Résumé du projet : Le projet TELELOCEM (Télétravail, localisations et émissions) est le fruit de relations scientifiques anciennes entre trois équipes de recherche qui proposent d’aborder ensemble une question que les récentes phases de confinement ont rendu cruciales. Le télétravail n’est plus une réalité marginale et ses impacts doivent être étudiés du point de vue des pratiques individuelles de mobilité. Il n’est plus un « objet sans désir » (Aguilera et alii 2012). De fait, ses effets collectifs sur l’environnement doivent être évalués.
Pour mesurer les impacts du télétravail, il est proposé d’étudier deux agglomérations urbaines (Lyon et Dijon) distinctes par leurs taille, configuration sociale et dynamisme économique. Le modèle MOSART, développé au sein de LAET, sera utilisé pour l’agglomération lyonnaise. L’outil de simulation MobiSim Soft, développé par le laboratoire THEMA, sera utilisé pour l’aire urbaine de Dijon.
4 scénarios sont envisagés pour permettre une approche pas-à-pas des impacts du télétravail, de la localisation des ménages et des effets rebonds.
![TELELOCEM : TELEtravail, LOCalisations résidentielles et EMissions]() TELELOCEM : TELEtravail, LOCalisations résidentielles et EMissions
TELELOCEM : TELEtravail, LOCalisations résidentielles et EMissions
Read more
Responsable scientifique : Partenaires : Living lab “le Dôme” (Caen) Financement : ANR 2016 Durée : 6 ans Résumé du projet : Le projet ANR Transition énergétique, territoires, hydrogène et société – (TETHYS) s’inscrit dans le champ de la démocratie technique pour aborder un ensemble de questions liées au processus de territorialisation de la transition énergétique par le vecteur hydrogène. Il va du suivi des démonstrateurs territoriaux constitutifs de filières industrielles dans les régions Bourgogne Franche-Comté et Normandie, lauréates de l’appel à projets « Territoire et Hydrogène » lancé en mai 2016 par le gouvernement français, dans le cadre de son programme de réindustrialisation du pays « Nouvelle France industrielle », à la mise en démocratie d’enjeux à la fois généraux et très pratiques, comme la production de scénarios de transition et de prototypes recourant au vecteur hydrogène. Il vise à dépasser les approches traditionnelles formulées en termes d’acceptabilité sociale des techniques et des risques. ll est porté par un consortium multidisciplinaire (sociologie, anthropologie des sciences et techniques, psychosociologie, aménagement de l’espace et urbanisme, droit de l’environnement, sciences de l’ingénieur, chimie physique) et multi-territorial basé sur deux structures fédératives de recherche que sont la Maison de la recherche en Sciences humaines de Caen et la Maison des Sciences Humaines en Bourgogne porteuse du living lab territorial pour la transition socio écologique.
![TETHYS : Transitions Energétiques Territoires Hydrogène et Société]() TETHYS : Transitions Energétiques Territoires Hydrogène et Société
TETHYS : Transitions Energétiques Territoires Hydrogène et Société
Read more
Responsable scientifique : Hervé MARCHAL (Laboratoire LIR3S – UMR CNRS-UB 7366) Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR 3516 CNRS-UB) – Laboratoire LIR3S (UMR CNRS-UB 7366) – Laboratoire THEMA (UMR CNRS-UB 6049) – Institut de Recherche en Économie de l’Éducation (IREDU) (EA 7318 – Université de Bourgogne) – Culture Sport Santé Société (C3S) (EA4660 – Université de Franche-Comté) – Laboratoire Psy-DREPI (EA 7458 – Université de Bourgogne) – Laboratoire ELLIADD (EA 4661 – Université de Franche-Comté) – Le Centre d’Economie et de Sociologie appliquées à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux (CESAER) (UMR INRAE 1041). Financement : AAP TTP (2019) Durée : Novembre 2019 – octobre 2020 Résumé du projet :
Le projet VIF propose une réflexion sur la ville de Dijon et ses frontières. Il s’agit de confronter les représentations de Dijon (de la ville, de ses quartiers et de différents lieux emblématiques) construites depuis le milieu du XXe siècle aux perceptions contemporaines de cet espace et aux usages qu’en font aujourd’hui « les Dijonnais ». Le rapport entre espace historiquement « conçu » par les pouvoirs politiques et médiatiques et espace « vécu » par les habitants est au cœur des interrogations des chercheurs.
Le projet propose de mettre en relation les représentations de l’espace dijonnais façonnées depuis 1945 par les pouvoirs politiques et médiatiques et les perceptions et usages contemporains de la ville.
Il porte, par ailleurs, une attention particulière à la construction sociale des limites (entre les quartiers mais aussi entre la ville et les espaces périphériques) en interrogeant le rapport entre limites « conçues » (par les pouvoirs) et limites « vécues » (par les habitants). Les enquêtes s’intéressent aux habitants de Dijon ainsi qu’aux occupants plus ou moins temporaires de l’espace (étudiants nouvellement installés dans la ville ou dont la vie s’organise entre le territoire d’origine et la capitale universitaire). Ainsi, la question des frontières et celle des migrations, qui figurent parmi les principales préoccupations de l’axe TTP, constituent des dimensions importantes de la recherche.
![VIF : La ville et ses frontières. Représentations et usages de l’espace à Dijon]() VIF : La ville et ses frontières. Représentations et usages de l’espace à Dijon
VIF : La ville et ses frontières. Représentations et usages de l’espace à Dijon
Read more
Responsable scientifique : Denis LEPICIER (Inrae) et LTTE (MSH Dijon – Université de Bourgogne). Partenaires : Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (UAR CNRS – Université de Bourgogne 3516) – Laboratoire THEMA – Université de Bourgogne – CESAER (INRAE – Institut Agro Dijon) Financement : CRBFC Durée : 24 mois Résumé du projet :
Le Living Lab pour la Transition Sociale-écologique (LttE) accompagne de 2020 à 2022, la Direction Aménagement du Territoire du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté) dansn la mise en place de l’opération « Villages du futur » (VDF), dispositif expérimental à l’échelle de 9 villages qui a vocation à aider les villages ruraux dans la mobilisation des capacités des villageois.e.s et de leurs représentant.e.s à imaginer un futur désirable.
L’appropriation de l’espace public passe par la capacité des habitant.e.s à créer collectivement un récit pour le devenir de leur village. Il s’agit alors d’identifier des situations-actions qui peuvent former des communs sociaux (Dardot et Laval, 2014), l’objectif étant que les habitant.e.s soient engagés dans la production et la gestion durable de ces communs. De fait, il s’agit de les associer activement à l’exercice du pouvoir local sous forme participative et délibérative en alliant idéalisation et action concrète.
Les chercheurs du LttE identifient des espaces de problématisation collective, scientifiquement dénommées « communautés épistémiques transdisciplinaires » (CET) (Berriet-Solliec, Lapostolle, Mangin et Roy, 2022). Ce processus s’appuie sur une démarche à inventer et concevoir selon la problématisation de la situation. Ainsi, le LttE ne postule pas une définition de la situation action et des règles du jeu : elles sont le produit de l’intelligence collective dans chaque village. Soutenir l’intelligence collective comme méthode, c’est poser que dans certaines conditions de débat, la pluralité des points de vue et types de savoirs donne des résultats plus robustes que la concentration d’un haut niveau de compétences et savoirs spécialisés (Hong et Page 2004).
![Village du futur]() Village du futur
Village du futur
Read more
Responsable scientifique : Héloïse HALIDAY (Laboratoire Psy-DREPI (EA 7458 – Université de Bourgogne) Partenaires : Laboratoire Psy-DREPI (EA 7458 – Université de Bourgogne) – Laboratoire de sociologie et d’anthropologie (LaSA) ( EA 3189 – Université de Franche-Comté). Financement : AAP TTP (2020) Durée : Janvier 2021 – Décembre 2021 Résumé du projet :
Le projet VIRALH-19 vise à étudier la façon dont la crise de la COVID-19 a impacté les directeurs d’hôpitaux (DH) en poste en BFC, au moyen d’entretiens semi-dirigés auprès des équipes de direction de 2 CHU et 2 CH, et avec deux hypothèses : 1°) le contexte sanitaire tendu a remanié la subjectivité des DH dans le sens d’une identification plus forte avec leur établissement et d’une dissolution de leur vie personnelle dans la vie institutionnelle de leur hôpital ; 2°) leur réseau interprofessionnel intra-établissement s’est réorganisé autour de nouvelles alliances et tensions relationnelles. Seront mobilisés, pour l’analyse des données, des apports en psychodynamique des systèmes, en psychodynamique du travail et en sociologie des professions.
Le projet rentre dans le cadre de l’axe « travail/pouvoir » : il vise à comprendre le vécu subjectif de DH placés en situation de gouverner une organisation subissant de fortes pressions sanitaires, économiques et sociales. Il touche également la dimension de « transmission », puisqu’il s’agit de comprendre comment le cadre organisationnel et interne (psychique) des DH peut perdurer en se réorganisant en temps de crise. Nous nous intéresserons à la représentation de leur institution qu’ils portent en eux (« institution-in-the-mind », Shapiro & Carr, 1991), à l’analyse qu’ils font des relations qu’ils entretiennent avec leurs collègues directeurs ainsi qu’aux autres professions de leurs établissements. Les risques en termes de santé et de santé mentale tels qu’auto-évalués par nos enquêtés feront l’objet d’une attention particulière.
![VIRALH-19 : Vécus de la vie Institutionnelle et Relationnelle à L’Hôpital en période de Covid-19 chez les directeurs d’hôpitaux]() VIRALH-19 : Vécus de la vie Institutionnelle et Relationnelle à L’Hôpital en période de Covid-19 chez les directeurs d’hôpitaux
VIRALH-19 : Vécus de la vie Institutionnelle et Relationnelle à L’Hôpital en période de Covid-19 chez les directeurs d’hôpitaux
Read more
Responsable scientifique : Fabrice MONNA – Laboratoire ARTEHIS (UMR CNRS-UB 6298) – Université de Bourgogne Partenaires : MSH Dijon (Plateforme GEOBFC) / MSHE Besançon / Chrono-Environnement (UMR 249) – Université de Franche-Comté / laboratoire IMB (UMR 5584) – Université de Bourgogne / Biogéosciences (UMR 6282) – Université de Bourgogne / Laboratoire de Géologie de Lyon (LGLTPE – UMR 5276) – Université Lyon 1 Financement : AAP RNMSH – MI INSHS Durée : 13 mois Résumé du projet : il s’agir d’établir une procédure d’utilisation des technologies numériques 3D allant de l’acquisition jusqu’à la diffusion, en passant par le traitement des formes des modèles. La région des marais de Saint-Gond (Marne) constitue un terrain d’étude particulièrement favorable car elle possède des structures néolithiques en trois dimensions, tout à fait remarquables : hypogées, minières de silex, habitats et “ateliers” de taille exceptionnellement bien conservés. Le projet est résolument interdisciplinaire et allie archéologie, géographie, muséographie, mathématiques, techniques de programmation, imagerie numérique, et morphométrie. Il permettra de répondre à plusieurs problématiques archéologiques qui s’articulent autour de deux axes de recherche : – la conservation, le partage des données et la muséographie ; – la détermination de la structuration spatiales et des techniques de construction.
Apport des technologies numériques à l’étude et à la restitution d’un site néolithique (VirtualNEO)